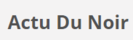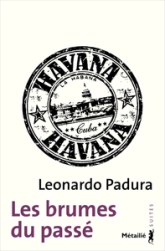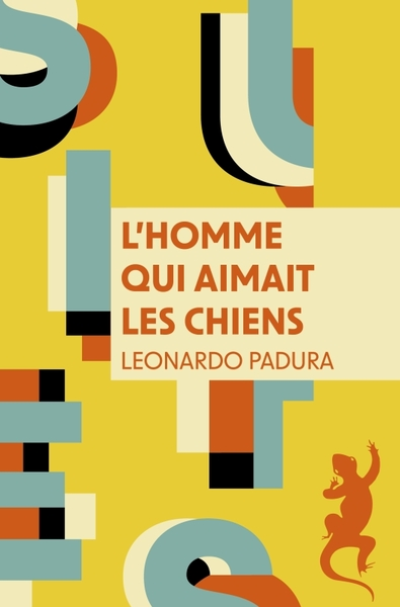
L'homme qui aimait les chiens
Résumé éditeur
livré en 5 jours
l’avis des lecteurs
Grande fresque au sein de laquelle fiction et réel s’entremêlent, "L’homme qui aimait les chiens" introduit, parallèlement au récit de deux véritables destins liés par l’Histoire -ceux de Trotski et de son assassin Ramon Mercader-, un troisième héros, fictif celui-là, en la personne d’Iván Cárdenas Maturell.
Au début du roman, ce dernier vient de perdre sa compagne Ana. On est en 2004, sur une île de Cuba traumatisée par la faim, les coupures d’électricité, la dévaluation des salaires, la paralysie des transports. Brisé par cette disparition, Iván est aussi un homme désabusé. Écrivain prometteur lorsqu’il était étudiant, la censure d’une de ses œuvres, qualifiée de contre-révolutionnaire, l’a condamné à végéter professionnellement. Il a lui-même capitulé en cessant d’écrire. La mort d’Ana le décide à reprendre la plume, et surtout à entreprendre la relation d’une histoire -"de haine, de tromperie et de mort"- qu’il avait tue, jusque-là, par peur. Elle résulte de sa rencontre, en 1977, avec un homme promenant régulièrement ses deux barzoïs sur la plage où lui-même avait coutume de marcher. Il reconstitue, à presque trois décennies de distance, les souvenirs des confidences que lui fit Lopez -ainsi que s’était présenté l’homme aux chiens- au fil de leurs conversations, tournant autour d’un sujet alors éminemment tabou et dangereux sur l’île : Trotski.
Comme pour illustrer, compléter, et surtout donner corps au témoignage d’Iván, le roman l’entrecoupe pour nous plonger, en alternance, aux côtés tantôt de Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le patronyme de Leon Trotski, tantôt de Ramón Mercader.
Nous suivons le premier alors que, expulsé du Parti puis de son pays, il est condamné à l’exil, d’abord à Alma-Ata, aux confins de la Russie asiatique (à la fin des années 20), puis en Turquie, en France, en Norvège, et enfin au Mexique où viendra en 1940 le chercher la mort en la personne du second. C’est une vie de de paria, à se comporter de sorte à ne pas gêner les hôtes qui l’accueillent, à se méfier de tout le monde, mais aussi une vie de passion et d’acharnement à continuer, à distance, le combat, malgré la frustration de ne pouvoir être au cœur des événements. Sa capacité d’action se réduit à l’écriture et la diffusion d’articles ou à organiser ses sympathisants dispersés, que son fils Lieva, notamment, basé à Paris, tente de fédérer et de mobiliser. Mais ses efforts, ceux d’un David contre un Goliath qui ne peut sortir que vainqueur, sont voués à l’échec. Trotski n’a plus de pouvoir, plus de parti, de moins en moins de fidèles. Et il fait l’objet par le pouvoir soviétique d’une campagne de dénigrement qui prend une ampleur démesurée et internationale. Instrumentalisée par celui qu'il surnomme "Le Montagnard", et dont il avait sous-estimé l’intelligence et l’habileté manipulatrice, son existence devient le prétexte qui justifie toutes les répressions. Présenté comme l’ennemi du peuple, il assiste, impuissant, aux purges, à la montée au pouvoir du nationalisme allemand, à l’effroyable pacte entre Hitler et Staline. S’ajoute l’angoisse qu’il éprouve pour les membres de sa famille -dont ses enfants- restés en Europe, voire en URSS, et qu’il sait en danger… et c’est en effet une véritable hécatombe, entre les internements, les suicides, les morts suspectes, les disparitions… Lui qui s’est battu pour un monde meilleur, n’a semé autour de lui que la douleur, la mort, l’humiliation. Lui-même se sait condamné, vit dans l’attente de la mort infâme qui surviendra quand il cessera d’être utile au Kremlin.
Et s’ajoute aussi le poids de la désillusion et d’une certaine amertume, face au constat que le pays où est née la Révolution est devenu un territoire dominé par la peur, perverti par la forme réactionnaire et dictatoriale du modèle socialiste qu’a imposé Staline. Quel ironique paradoxe, que de réaliser qu’une une fois concrétisé le rêve socialiste, il est nécessaire d’appeler le prolétariat à se rebeller contre son propre état… Il analyse, enfin, ses propres manquements, conscient de la violence parfois tyrannique dont il a preuve, sait qu’il ne pourra jamais se pardonner d’avoir employé certaines méthodes coercitives à la reconstruction de l’après-guerre.
C’est un homme rongé par l’épuisement, de plus en plus seul, si ce n’est sa fidèle et endurante épouse Natalia. Un homme entouré de fantômes, ceux de sa famille, de ses camarades, de ceux qui l’ont renié, se sont éloignés de ses idées, auxquelles lui reste férocement et jusqu’au bout attaché, ne vivant jusqu’à son dernier jour que dans le seul but de restaurer la révolution telle qu’elle fut déterminée à son origine. Et jusqu’au bout, malgré cet épuisement, l’image qu’on en garde est celle d’un individu charismatique, exigeant à l’extrême, intransigeant, aspirant tous ses proches dans le tourbillon de son dévouement à une cause, celle du prolétariat, de la révolution ouvrière. Un individu capable de paralyser ceux qui l’approchent, sa façon de vivre et de penser -cette existence exclusivement vouée à l’opposition vis-à-vis de la totalité des pouvoirs du monde : fascisme, capitalisme, stalinisme, religions…- provoquant chez ceux eux une tension morale presque insupportable.
Paradoxalement, ce combat est similaire à celui de son assassin, Ramón Mercader, qui rêve et lutte pour un monde sans exploiteurs ni exploités, sans haine et sans peur. Issu d’un milieu bourgeois, il vient à la cause prolétarienne influencé par sa mère Caridad. Celle-ci, après avoir fréquenté par haine de son mari les milieux populaires les moins reluisants de Barcelone, se convertit à l’anarchie, puis emmène ses enfants vivre avec elle en France. Au moment de la guerre civile espagnole, Ramón combat avec les Républicains, soutenus par l’URSS alors en lutte contre les nationalistes, mais aussi contre les factions internes qui menacent son hégémonie : anarchistes, trotskistes… C’est ainsi que s’éveille son inébranlable haine pour ces derniers, ennemis les plus ambigus des communistes, Trotski représentant quant à lui le plus sournois et le plus malfaisant des adversaires.
Alors qu’en Espagne, la guerre a tourné au profit des franquistes, sa mère met Ramón en relation avec un homme énigmatique qui le recrute pour une mission ultra-secrète et de la plus haute importance, en vue de laquelle il est entraîné psychologiquement et physiquement dans un camp russe, où il apprend aussi l’art de la transformation. Car à partir de là, fini Ramón Mercader. Le barcelonais va vivre plusieurs vies, sous d’autres noms, dans d’autres peaux, avec comme but ultime d’approcher son ennemi suprême, carte clandestine et ultime dans le jeu de ses commanditaires dont l’objectif est l’élimination du traître Trostski. L’homme de terrain adopte une autre forme de combat, fait de dissimulations, de simulations, nécessitant patience et sang-froid.
"L’homme qui aimait les chiens" est un roman dense et addictif, haletant malgré l’issue que l’on sait inéluctable. C’est aussi un roman poignant, hanté de bout en bout par l’échec, à une époque où le doute était interdit, d’une des plus grandes utopies que l’homme tenta de concrétiser, l’amère désillusion face à un système né pour l’égalité et la dignité de tous, et qui se retourna contre ceux pour lesquels il avait été érigé. Les héros qu’il met en scène en deviennent des symboles -sans pour autant que leur complexité et leur dimension palpable en soient égratignées- du revers des luttes idéologiques : la violence, les sacrifices jugés inhérents au combat pour un monde meilleur, l’aveuglement face l’irréalisme d’un rêve perverti par ses propres instigateurs… le "rêve strictement théorique et si attirant de l’égalité possible, (…) remplacé par le grand cauchemar autoritaire de l’histoire lorsqu’il s’appliqua à la réalité".
Comme si l’idéal était trop grand pour les hommes, et qu’il les amputait de tout discernement.
Un très grand roman.
Il sort jeudi et son auteur sera en France en janvier, avec entre autres une visite à Toulouse le mardi 11 à Ombres Blanches. C’est un roman historique écrit par un écrivain de polars, c’est un roman à portée mondiale écrit par un cubain, c’est sans conteste l’un des chocs de cette rentrée 2011, c’est L’homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura.
1977, Ivan, journaliste et auteur cubain frustré rencontre sur une plage proche de La Havane un homme malade qui promène deux magnifiques lévriers russes. Un homme étrange qui semble se prendre d’amitié pour lui et lui confie, au fil des rencontres, l’histoire de Ramon Mercader, l’assassin de Trotski. L’homme n’a pas le temps de tout raconter avant de disparaître, mais il a le temps d’exciter la curiosité d’Ivan, réveillant peu à peu son envie d’écrire.
Ce n’est qu’en 2004, à la mort de sa femme, qu’Ivan va sauter le pas et se décider enfin à écrire son grand roman, grâce à ses confidences, aux recherches qu’il a faites et à différents documents que de mystérieux inconnus lui ont fait parvenir après la disparition de l’homme aux chiens.
Magistral, monumental, impressionnant … Et bien plus que ça. Plus de six cent pages qui reviennent sur la vie de Trotski en exil, sur la lente fabrication de Ramon Mercader, alias Jacques Mornard, jeune républicain espagnol manipulé et façonné pour devenir un assassin, le meurtrier du paria le plus célèbre du XX° siècle, et sur la vie d’un écrivain brisé à Cuba entre la fin des années 70 et le début du XXI° siècle.
Plus de six cent pages à côtoyer l’Histoire, à la raconter au travers de mille histoires. A décrire le lent cheminement qui aboutit à l’assassinat de Trotski, mais également à celui de millions d’hommes et surtout à celui de la plus belle idée du XX° siècle, confisquée et pervertie par ceux qui, par la terreur, ont trahis ceux qui croyaient œuvrer pour le bien de tous. Au point que cette idée pourtant généreuse est maintenant automatiquement associée à cette terreur (ce qui arrange bien les tenants de l’individualisme forcené autre nom du capitalisme).
Le roman nous fait voyager, dans le temps et dans l’espace, côtoyer des légendes, redécouvrir de l’intérieur les plus grandes polémiques politiques du siècle passé. Il nous fait toucher du doigt les haines féroces qui ont opposé des hommes qui pourtant auraient dû travailler ensemble. Il explique pourquoi, 70 ans plus tard, les gauches sont toujours aussi dispersées, pourquoi souvent on a l’impression que le pire ennemi est celui qui devrait, en toute logique, être l’allié le plus proche.
Sans oublier que Padura est un auteur de romans policiers. Un auteur qui maîtrise à la perfection sa construction pourtant complexe, qui jongle avec les lieux et les temps, et qui, sans qu’on s’en rende bien compte au début, tricote merveilleusement son intrigue pour créer une tension grandissante, jusqu’à être quasi insupportable à l’approche du dénouement. Le chapitre consacré aux dernières minutes avant l’assassinat est, à lui seul, un pur chef-d’œuvre.
Un roman indispensable. Un roman éblouissant pour commencer cette année 2011 en beauté.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés