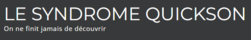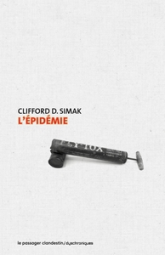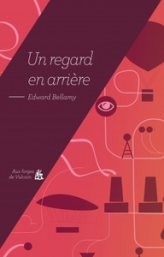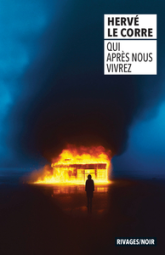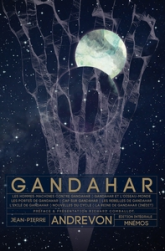Demain les chiens
Résumé éditeur
En stock
l’avis des lecteurs
Cette chronique sera avant tout l’histoire d’une erreur : la mienne. Commençons donc par une confession, en lien sans doute avec mon rapport difficile avec ce qu’on appelle communément les « Classiques », en Imaginaire comme dans tous les domaines, y compris en dehors de la Littérature. J’avais déjà eu l’occasion d’en parler par ici. Il ne s’agit pas de rejeter en bloc ces œuvres qui ont su traverser le temps, mais plutôt leur traitement par ce que j’appellerais sans trop de diplomatie « les gens qui savent » ; cette partie de la population censément savante qui se sclérose fièrement dans une vision élitiste de la culture, se faisant gardienne d’une porte qu’elle seule a bâtie, à la fois pour empêcher trop de gens comme d’œuvres de rentrer dans ce qu’elle considère comme un saint-des-saints. Ma confession – on y vient – est donc celle-ci : j’ai beaucoup de mal avec les explications de texte. À comprendre, les explications qui font office de canons invariables, celles dont on ne peut plus dévier, qui se substituent à l’intention de l’auteur comme à la relation que je tiens comme sacrée entre les lecteurices et le texte, seul·e·s. Et si certains sens, tirés des textes, sont établis à raison et pérennisés sans excès, j’ai toujours du mal avec cette relation quasi cultuelle qui se crée parfois entre une communauté et ces textes ; où un consensus semble se créer et laisser quelques personnes sur le côté, arguant que si elles ne sont pas inscrites dans ce consensus, c’est par un défaut de compréhension ou de culture générale, et non pas simplement par une incompatibilité de lecture et d’interprétation.
Or, la communication, surtout à l’écrit, brouille facilement le message d’origine. Et parfois, à l’aune d’un mot de différence, on perd beaucoup d’informations. Et ainsi, intervient l’objet qui m’a amené à monter toute cette réflexion d’introduction. Promis on parlera du livre en lui-même à un moment, mais accrochez-vous, c’est important pour que je sois parfaitement clair. Cet objet de réflexion, ce sont les notes d’éditeurs. Dossiers, préambules, une bonne partie du para-texte, finalement, qui parfois se disperse tout le long d’un ouvrage pour en exposer les entrailles et les détails « cachés ». Au delà des ouvrages destinés au monde scolaire, j’ai souvent croisé ces pastilles de réflexion, pas dénuées d’intérêt dans une optique purement universitaire, ou pour les plus curieux·ses et passioné·e·s. Mais si elles ne sont pas dénuées d’intérêt, elles ont souvent le défaut de partir du principe que cielle qui tient l’ouvrage entre ses mains a déjà lu l’ouvrage dont elles traitent. Et donc expliquent tout sans prendre la peine de cacher ou camoufler la majorité des enjeux ; ce qui a souvent deux effets néfastes : spoiler salement, et surtout, graver au fer rouge certains enjeux dans l’esprit de la personne qui lit, et alors, impossible d’en faire fi pendant la lecture, et donc de se créer une opinion vierge de toute influence. Or, il est important de pouvoir, tout de même, de prime abord, se faire son propre avis, quitte à se tromper, en l’absence de certains éléments. Ça apprend la vigilance, l’esprit critique et ça exerce l’esprit. Si on prémâche tout, plus aucun intérêt à découvrir. Je considère qu’il vaut mieux être un feu qu’on allume plutôt qu’une amphore qu’on remplit, comme disait Montaigne. [EDIT : On m’a signalé que c’était à Plutarque qu’il faudrait plutôt attribuer cette citation précise, et non Montaigne, qui disait plutôt qu’il « préférait une tête bien faite à une tête bien pleine ». Au temps pour moi.]
Tout ça pour dire que moi, ça, ça me hérisse méchamment le poil, je suis un petit peu traumatisé. Si je ne lis plus les résumés en quatrième de couverture et que j’essaie de connaître un minimum de choses des ouvrages que je découvre, c’est précisément pour le faire d’une façon aussi libérée que possible, sans influence extérieure, sur mon ressenti comme sur mes interprétations.
Et c’est pour ça que j’ai commis l’erreur que j’admettais en début de chronique (on y est presque, encore un tout petit effort). Lorsque j’ai aperçu une « note de l’éditeur » en début d’ouvrage, ainsi que des « notes » en préambule de chacun des contes qui constituent Demain les chiens, que je croyais attachées à une volonté de l’éditeur, j’ai pris ça pour ce que je déteste : de l’explication de texte préalable au texte. Et je n’en voulais pas. Pas du tout. Alors, pendant 200 pages, je les ai sautées, pour éviter ces mauvaises influences et me concentrer sur ce que je pensais être l’essentiel du texte. Ce qui m’a amené à me poser certaines questions sur le texte que j’étais en train de lire, forcément. Par chance, Twitter étant un endroit parfois formidable, j’ai pu poser quelques questions à Pierre-Paul Duranstanti, traducteur de la version dont je me suis porté acquéreur, afin d’éclaircir certains points qui me contrariaient un peu. Et bon sang que je le remercie (très chaleureusement) pour le temps qu’il m’a accordé ainsi que pour sa bienveillance. Parce que sans son intervention, je ne me serais sans doute pas rendu compte du chef d’oeuvre que j’avais entre les mains.
Tout ça pour dire que cette chronique – qui arrive enfin, merci de votre patience – sera grandement marquée par les allers et retours entre mon ressenti premier, affecté par un manque cruel d’informations et un manque de confiance de ma part envers le livre, et le second, qui lui, se base sur ma connaissance pleine et entière de ce dernier. Parce qu’en fait, ces notes font bien partie intégrante du texte. Et y sont, de fait, absolument essentielles. J’oserais dire qu’elles lui confèrent ses plus grandes qualités ; j’irais même jusqu’à dire qu’elles lui donnent du génie.
Mais trève d’introduction, il s’agit maintenant d’expliquer pourquoi ce livre mérite bel et bien son statut de classique à mes yeux.
Vous aurez peut-être noté que je n’ai pas utilisé le terme de « roman » pour désigner Demain les chiens. En effet, je le considérerais plus volontiers comme un fix-up. Huit contes, introduits en premier lieu par cette fameuse « note de l’éditeur », qui fait partie intégrante du récit, puisque l’éditeur en question n’est pas humain, et appartient lui-même au récit qui nous est proposé. Et les notes en préambules de chaque conte, de la même façon, sont des introductions qui en complètent l’interprétation, du point de vue des chiens du titre, dans un futur lointain. Au contraire de mes craintes donc, il ne s’agit pas de resserrer de façon stérile et élitiste les frontières des exégèses possibles de ces contes, mais bien de les élargir, de l’intérieur même du texte. Une fois que j’ai compris ça, curieusement, le texte a pris une toute nouvelle dimension dans mon esprit ; puisque tout ce qui créait le doute ou me faisait grincer des dents prenait ainsi un ou plusieurs sens nouveaux. Exit le doute, bonjour le pur et puissant sense of wonder. Merci Pierre-Paul Durastanti, vraiment, ç’aurait été vraiment très dommage de passer à côté de ce texte.
Au niveau de l’histoire donc, ces huit contes forment une collection de récits, réunis par les chiens, devenus intelligents et doués de parole, peuplant ce qu’il reste de la Terre, bien après la disparition de l’homme, dont ils tentent, tant bien que mal, de faire sens, afin de mieux comprendre leur histoire et ce qu’ils en ignorent.
Et voilà. Un point de départ d’une extraordinaire simplicité, mais dont Clifford D. Simak parviendra a tirer, au fil de cette édition finale de textes, écrits à une certaine distance temporelle les uns des autres, une incroyable et évocatrice cohérence. N’y allons pas par quatre chemins, c’est riche, très riche. L’ambition me semble assez claire : au travers de la vision des chiens, établir le parcours de l’espèce humaine, depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale jusqu’à un futur si éloigné qu’elle n’y existe plus, et que les chiens en viennent à même douter de son existence. La notion de conte devient alors essentielle à la bonne compréhension de l’ensemble de l’ouvrage, puisqu’elle permet et explique tout autant certains errements du textes, incohérences, tant scientifiques que narratives, qui sans les explications en préambule auraient sans doute pu être dommageables. « Pu », seulement, car si j’ai su rattraper ces notes en cours de route et donc me remettre plus facilement dans le bon sens de la marche, je crois que les contes en eux-mêmes contiennent les éléments nécessaires à la compréhension de l’ouvrage dans sa globalité. Les notes ont l’immense avantage, finalement, de clarifier ses plus grosses difficultés en amont, permettant à un lectorat plus impatient ou moins analytique d’éviter de laisser tomber en cours de route, faute d’un sens profond qui mettrait trop de temps à se révéler.
Mais il apparaît, au travers de l’étude de ces histoires que font les chiens, que Clifford Simak interroge bien d’autres choses que cet hypothétique rapport entre l’Humain et les chiens. Les couches d’interprétations sont multiples, et évoquent autant de problématiques canines futures que des problématiques complètement humaines, toujours contemporaines, et donc passées. Cette collection de contes fictifs, censément partagés de façon très orale par ces chiens du futur ont, paradoxalement, une qualité intemporelle. Leurs questions sont les nôtres, malgré les différences, leurs termes sont trop similaires pour être ignorées ou défaussés sans examen. La principale, et la mieux traitée à mes yeux, de très loin, est celle de l’altérité, et de la force de cette dernière. Simak ne se contente pas d’évoquer l’idée que deux cerveaux sont mieux qu’un, il le prouve. Il s’appuie sur l’idée à la fois simple et complexe qu’un organisme différent du nôtre, ayant évolué d’une autre façon que nous, a forcément une façon de penser qui s’oppose à la nôtre, et donc la complète ou la surpasse, permettant de combler des trous dont on ignorait même l’existence. Je pourrait ici m’étendre sur le Juwainisme, concept pivot de l’ouvrage, mais je préfère en laisser la complète primeur à cielles qui voudraient tenter la découverte. Ce n’est pas le concept le plus révolutionnaire de tous les temps, et il est volontairement présenté de façon assez caricaturale, puisque au sein d’un récit décousu et auquel on ne peut pas prêter une foi infinie. Mais par les temps qui courent, j’admets que voir quelque chose en quoi je crois depuis un certain temps sans avoir su l’exprimer aussi bien, ça fait quelque chose, et je garderais cette idée avec moi aussi longtemps que je me souviendrais de cet ouvrage.
Et pour sûr, je ne risque pas de l’oublier de sitôt. J’ai rarement pu lire un texte jouant aussi habilement sur différents registres, sans jamais se dédire ni tricher pour parvenir à ses fins, tout en jouant avec toutes les armes à sa disposition. L’aspect quasi-biblique de cet ensemble de contes décousus, aux enjeux multiples, et parfois contradictoires d’un texte à l’autre, participe finalement de sa cohérence, et de son questionnement majeur. Car si les chiens, au stade d’évolution où ils sont parvenus, se posent des questions sur leurs origines et leur destin, alors peut-être devrions nous aussi nous en poser. Pas forcément dans les mêmes termes, mais cette nécessité se fait assez évidente alors que les chiens eux-mêmes ont toutes les raisons de douter de ce qu’ils présentent comme évident et indiscutable, dans bien des domaines. Avec ou sans les notes, c’était l’aspect le plus passionnant de ces contes, et une des choses que je préfère lire dans un ouvrage littéraire : de bonnes questions, nées de doutes légitimes et bien formulés, sans réponses péremptoires. Demain les chiens est un ouvrage sur l’histoire, la mémoire et le devoir. Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes, comment le sommes-nous devenu·e·s et pourquoi continuons-nous dans cette voie qui a été semble-t-il tracée pour nous avant même notre naissance, ou à notre insu, sans jamais réellement la remettre en question ? Et l’Histoire a dans ces récits un poids particulier, puisque nous y voyons facilement les trous, les incohérences, les erreurs, comme les symboles et les métaphores, dont les chiens tirent des interprétations différentes, encore différentes de celles que les lecteurices peuvent facilement faire, de l’extérieur, ce qui n’est pas sans une certaine ironie. Dans ces contes, nous décelons les facilités, les arnaques, les constructions thématiques, quasi-prescriptives, puisque nous les avons vécues, tout ou partie, nous aussi ; nous en avons une certaine mémoire. Et pour autant, nous semblons régulièrement incapables de les déceler dans nos propres histoires. Le paradoxe est cuisant, et terriblement bien évoqué. La certitude est le luxe des spectateurs, peu importe la distance. C’est la directe proximité qui crée le doute, comme l’impérieuse nécessité de l’effacer, juste pour pouvoir continuer à avancer.
Et c’est précisément dans la forme qu’adopte Simak que se niche – si j’ose dire – tout le génie de son oeuvre, et donc son intemporalité. Les questions soulevées par les chiens et leurs contemporains, nous ne cesserons jamais, nous-mêmes, de nous les poser. L’auteur évoque, cyniquement, de son propre aveu, et avec une certaine lassitude bien compréhensible, des perspectives difficiles pour l’espèce humaine, liées pour beaucoup à notre incapacité à évoluer assez vite, et donc à nos déboires cycliques. Pas tant par la faute de l’espèce elle-même que par la faute des mécaniques inhérentes à l’Histoire elle-même. Et si tout l’ouvrage est parcouru d’une parfois difficile mélancolie et d’un certain fatalisme, pour autant, il est aussi habité d’un réel optimisme. Un équilibre précaire et presque impossible à conceptualiser, que j’ai pourtant puissamment ressenti, je crois grâce à une qualité majeure : Clifford D. Simak ne pointe pas de doigt accusateur. Son constat est certes amer, mais pas dénué de bienveillance. Nous sommes, selon lui, destinés à nous éteindre, mais pas nécessairement par notre pleine et entière faute. Il n’est pas question ici de nihilisme négatif, mais d’évoquer nos possibilités de retarder l’inévitable, comme de laisser une trace positive sur ce qui nous succédera. Il est autant question d’Histoire que de sa transmission, et donc d’héritage, des choix et efforts que nous pouvons et devons faire dans ce sens. Tout ce qui disparaît a le potentiel de laisser une trace, quelle sera donc la nôtre ?
Inutile, je crois, d’en rajouter. Certaines œuvres sont indiscutables dans leur réputation. Sans doute parce qu’on n’aura jamais réellement fini d’en discuter, précisément. Je suis très heureux d’avoir été suffisamment curieux pour enfin m’attaquer à un monument qui me faisait un peu peur par son potentiel de déception, comme d’ennui. Et doublement heureux qu’il m’ait rendu suffisamment curieux pour poser les questions que j’ai posées à Pierre-Paul Durastanti, je m’en serais terriblement voulu de passer à côté d’une telle baffe. Surtout quand elle a pris 70 ans d’élan. Car oui, si par certains aspects, cet ouvrage a effectivement vieilli, par la force des choses et des temps qui changent, l’essentiel de son message s’affranchit aisément des années et m’a conquis par son incommensurable intemporalité, et c’est bien ça sa plus grande qualité. À l’instar des plus grands romans et textes de toutes tailles, Demain les chiens aura toujours quelque chose à nous dire. Ou à nous aboyer, à la rigueur.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés