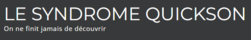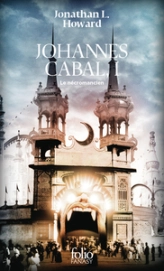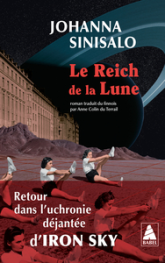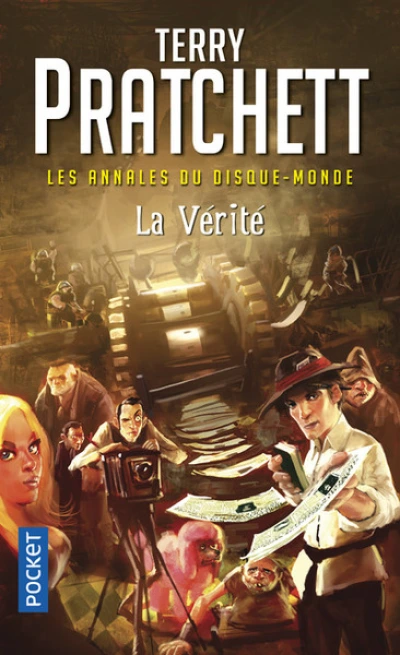
Les Annales du Disque-Monde Tome 26 La vérité
Résumé éditeur
En stock
livré en 4 jours
l’avis des lecteurs
Ça faisait trop longtemps, clairement. Je n’ai aucune excuse, plutôt une explication. Malgré la qualité des romans du Disque, je crains à chaque nouvelle occurrence d’avoir de moins en moins de chose à dire, ou alors de devoir lutter de plus en plus avec moi-même pour articuler les idées de Terry Pratchett au mieux dans mes chroniques du Tour du Disque. Et comme les circonstances sont un peu complexes, pour être honnête, forcément, la perspective de ce volume en particulier était une couche de complexité supplémentaire dont je me serais bien passé. Disons que les qualités de miroir déformant du Disque-Monde ont beau être ce qu’elles sont, parfois, j’aimerais pouvoir un peu oublier le monde dans lequel nous vivons.
Mais bref, j’ai passé le cap, et j’ai lu La Vérité. Dont mon souvenir était évidemment flatteur, comme pour tous les romans du Disque-Monde ou presque, maintenant que nous avons allégrement passé la vingtaine dans la tomaison. Je pensais avoir oublié quelques menus détails en dehors d’une vision globale bien tenue. Comme toujours, avec la distance et l’absence d’une réelle lecture critique à l’époque de ma première lecture, j’avais oublié beaucoup plus que je croyais, et c’est heureux, comme à chaque fois.
Quelques très légères déceptions sur lesquelles nous reviendrons, mais dans l’ensemble, bien sûr, ce tome est un excellent tome, d’autant plus qu’il révèle quelques petites choses inattendues sur Terry Pratchett et ses choix quant à ses Annales ; ce qui fait toujours plaisir, surtout pour moi, évidemment.
Allez, on se presse, on s’y met.
« Un auteur de fantasy doit parfois attirer l’attention sur l’étrangeté de la réalité. »
Ankh-Morpork est, comme à son habitude, en pleine mutation. Au gré de celle-ci et de la présence des Nains dans la ville, l’imprimerie fait son grand retour là d’où elle a pourtant été bannie il y a fort longtemps, à cause de l’influence des mages qui y voient une trop belle occasion pour les mots et les lettres de prendre le pouvoir. Mais « le monde tourne,[…] et nous devons tourner avec lui », comme le dit le Patricien. Et ainsi, le jeune Guillaume des Mots, aristocrate en quête d’émancipation de sa famille aristocrate, voit dans l’imprimerie l’occasion de faciliter son activité de rapporteur de nouvelles pour les grandes familles qui le sollicitent un peu partout.
Le doigt a été mis dans l’engrenage, et la mécanique du progrès est en route. Personne ne pourra l’arrêter.
« La différence entre la solution de difficulté et la solution de facilité, c’est que celle de la difficulté marche. »
Le premier constat que j’ai fait à la lecture de La Vérité, c’est que cette histoire aurait pu, et sans doute du, d’un certain point de vue, appartenir au cycle du Guet. Tous ses ingrédients habituels y sont réunis, en plus de l’évidente justification des thèmes abordés, sans parler de la continuité narrative et thématique directe avec Le Cinquième Éléphant. En effet, on retrouve l’idée d’une accélération technologique, amenant une mutation profonde de la société Morporkienne, culturellement comme démographiquement ou sociologiquement ; puisque la présence des Nains et les conséquences de l’immigration sont encore une fois centrales, bien que relativement discrètes à l’échelle de l’intrigue. Beaucoup d’autres auteurices que Terry Pratchett, à sa place, auraient pu, je pense, enchaîner très directement les deux volumes, et continuer à creuser les thèmes choisis au travers de ses personnages du Guet, et faire de Guillaume des Mots un personnage secondaire, suivi au travers de Vimaire et son équipe. Le roman aurait d’ailleurs sans doute fonctionné, puisqu’il aurait convoqué les thèmes habituels de ce cycle, entre analyse sociologique et intrigue politique, avec les mêmes antagonistes et seulement quelques différences de traitement avec ce que nous avons finalement eu.
Mais comme l’indique la citation que j’ai décidé de placer en exergue de ce paragraphe, le choix de l’auteur a été différent, et sans doute le meilleur, parce que plus complexe à mettre en place et à exécuter. Le souci avec le Guet, et particulièrement Vimaire, c’est qu’il est vraiment devenu, à ce stade des Annales, trop puissant. À la fois dans la diégèse et narrativement parlant. Le commissaire divisionnaire déborde, en quelque sorte, irradiant bien au delà de sa propre ville et de ses propres histoires : il a gagné. Il aura beau avoir ses propres histoires, encore, et des problèmes à régler, les enjeux de ses luttes ne seront plus jamais aussi importants qu’ils ne l’ont été jusque là, à moins de « tricher » (c’est toi que je regarde, Ronde de Nuit).
Mais, comme c’est à Ankh-Morpork que tout ce qui est important à l’échelle du Disque-Monde se passe ou presque, il a fallu à Terry Pratchett ruser un peu, et trouver de nouveaux points de vue à exploiter pour pouvoir montrer ce qui se passe durant la révolution industrielle de la ville amorcée dans les tomes précédents, amorcer le cycle du Progrès qu’on retrouvera avec Moite von Lipwig notamment ; changer les perspectives. Ainsi, on assiste à des événements qui découlent directement de tomes précédents, des conséquences indirectes ou directes des aventures de Vimaire, dont il est désormais plus spectateur qu’acteur. On passe de romans policiers à un thriller politique dont nous avons beaucoup plus d’éléments à disposition, dans des progressions parallèles plutôt que dans une mono-linéaire. Si comme je l’ai dit certains enjeux et thèmes proviennent du Cinquième Éléphant, on peut aussi deviner que d’autres proviennent de Va-T-En-Guerre. Encore et toujours, rien n’est laissé au hasard, Terry Pratchett fait pousser au mieux les graines qu’il a semées pour lui même, travaillant ses idées au fur et à mesure qu’elles s’éclaircissent dans son esprit.
« Si c’était dans le journal, c’étaient des nouvelles. Si c’étaient des nouvelles, elles avaient leur place dans le journal, et si c’était dans le journal, c’étaient des nouvelles et c’était la vérité. »
Bien entendu, le thème central, évident, de La Vérité, c’est la naissance du journalisme et de la presse écrite, mais surtout leur fonctionnement, bien au delà du simple contexte de la révolution industrielle. À l’échelle du roman lui-même, évidemment, les choses vont très vite, pour permettre à Terry Pratchett de déployer tous ses talents d’observation, décortiquant au passage beaucoup des caractéristiques et petits paradoxes du travail de Guillaume des Mots et ses comparses, sous de nombreux aspects, politiques ou plus triviaux.
Tout part d’un constat essentiel du tome précédent que l’auteur développe ici, dès le départ du roman d’ailleurs, avec la rumeur selon laquelle les nains ont réussi à transformer le plomb en or : l’information est devenu une ressource précieuse. Or, à partir du moment où une ressource est précieuse, elle est recherchée par tout le monde, et donc se démocratise, fluidifiant autant que complexifiant sa circulation. Un journaliste, dans cet intervalle, n’est rien d’autre qu’un receleur d’informations, ces dernières gagnant en valeur en fonction des interlocuteurices et de leurs besoins. Ce qui intéresse les nobles auxquelles s’adresse Guillaume dans ses petits bulletins au départ n’intéresse pas nécessairement le commun des mortels, nécessitant donc de rechercher et distribuer- ou faire disparaitre – ces informations différemment. Le processus en lui-même n’a rien d’extraordinaire, mais l’illustration qu’en fait Terry Pratchett dans le contexte d’Ankh-Morpork me parait limpide.
À partir de là, il déconstruit assez habilement les tenants et aboutissants du journalisme moderne, sa place dans un régime politique, ses responsabilités comme ses obligations. Et donc l’argent. Guillaume ne veut pas se faire d’argent – du moins trop d’argent – avec son journal, mais en a besoin en quantité, tout de même, pour continuer à vivre et faire vivre le métier qu’il est en train d’inventer. Il y a contradiction dans les termes, malgré une terrible continuité logique. La question est passionnante et soulève bon nombre d’enjeux qui la dépassent ; parce qu’avoir besoin d’argent dans un système proto-capitaliste comme celui d’Ankh-Morpork, c’est aller au devant de nécessaires et déplaisants compromis et sacrifices de vertu.
Bien au delà de devoir mettre les noms des gens dans le journal pour leur donner envie de le lire par simple narcissisme ou inclure des brèves concernant des légumes à la forme amusante, finalement raconter ce que le Patricien appelle par ironie des « anciennes« , des nouvelles qu’on connait déjà mais qu’il est confortable de se voir répéter ; Guillaume des Mots et son équipe doivent faire des choix. Choisir avec qui s’entendre ou se fâcher, comment se financer, comment louvoyer avec leur place naissante dans le jeu d’influence terrible de la vieille aristocratie morporkienne, choisir en somme quelle vérité raconter : quelles informations relayer, et comment, tout simplement. Mais ô comment difficilement.
« Les mensonges pouvaient faire le tour du monde le temps que la vérité enfile ses chaussures. »
Terry Pratchett compose autour de cette question notamment à l’aide de cette citation-clé qui revient régulièrement sous de nombreuses formes et avec autant de significations dans le roman, comme l’ombre omniprésente de celui qui la prononce bien volontiers, à savoir le père de Guillaume des Mots, seigneur morporkien, avatar de l’aristocratie puissante que l’auteur se plaît à épingler volume après volume. Et, composant avec cette présence, il développe beaucoup de ses thèmes, nouveaux comme favoris, à partir des bouleversements qu’apporte le journalisme naissant à une cité telle qu’Ankh-Morpork.
Le premier, et sans doute le plus important de ces thèmes, c’est l’importance de la presse comme contre-pouvoir politique. Dans une société comme celle que dépeint Terry Pratchett, ou l’aristocratie a pendant longtemps détenu une grande part de pouvoir part la seule force de sa noblesse et des avantages financiers qui vont avec, le contrôle de l’information est un aspect comme un autre de ce pouvoir. De fait, la démocratisation des informations et leur diffusion à un public plus large est un danger : il est plus facile de tirer les ficelles depuis les ombres que depuis la lumière. Dès lors que les choses se savent, les témoins se multiplient et le prix de la confidentialité augmente. Et donc la presse devient un moyen de lutte, par la simple mise en lumière et la diffusion de ce qui par le passé pouvait être dissimulé : c’est un changement de paradigme en soi.
Et à partir de là, l’intrication de cet enjeu avec celui du financement met en lumière un autre enjeu qui en nait directement : l’information devient un business, et donc une autre arme potentiellement aux mains des gens qui ont la main dessus. Là où Guillaume estime simplement important de partager les informations qu’il découvre à la population, son père et ses comparses n’y voient qu’un autre moyen de contrôler l’opinion à leur bénéfice. Et rentre alors en jeu Planteur J.M.T.L.G., toujours là lorsqu’il s’agit de se faire de l’argent facile sans effort ni déontologie. Et si on peut imaginer que son ersatz de journal, volontiers évocateur d’une presse à scandales/complotiste, n’est qu’une satire narquoise, Terry Pratchett lui prête le défaut bien plus grave d’être surtout confusionniste et parasitaire. Le parallèle avec ses saucisses dans des petits pains prête à sourire, mais l’explication est nette. Ce genre d’infos est fondamentalement mauvaise, on le sait, mais on y revient toujours, autant par acquit de conscience que par curiosité malsaine et un étrange, instinctif, et inexplicable goût de reviens-y.
Or, plus on consomme ce genre de nouvelles, moins on consomme des autres, plus on s’endort : les informations elles-mêmes finissent par avoir une influence sur notre façon de les percevoir. Et donc, quand l’aristocratie morporkienne essaie de faire taire Le Disque-Monde de Guillaume en lançant une concurrence moins chère et plus putassière pour l’ensevelir, c’est une démarche politique autant que financière ; c’est un investissement qui fait se confondre le champ économique et le champ politique au sein du champ informationnel qui les contient finalement tous les deux, dans ce nouveau paradigme en train de se construire.
« Pour la classe sociale dont était issu Guillaume, la justice, c’était comme le charbon ou les pommes de terre. On en passait commande quand on en avait besoin. »
Pour être tout à fait honnête, j’ai du moi-même me réfréner de faire des parallèles trop contemporains entre les théories que Terry Pratchett développe dans ce roman et ce qu’il pouvait m’évoquer de notre réalité avec plus de 20 ans d’écart. Mais pour autant, je dois saluer la qualité de lucidité, quasi visionnaire de l’auteur, à deux niveaux, en nuançant bien les deux. Ce premier aspect, c’est celui de la frénésie informationnelle, à laquelle succombent Guillaume et son équipe, me faisant régulièrement penser au système médiatique dans lequel nous baignons actuellement, où être premier sur l’information passe régulièrement devant l’importance de livrer une information complète et qualitative. Où la réaction, le narcissisme (« Les noms font vendre ») finissent presque par avoir plus d’importance que l’information et ses conséquences iels-mêmes, dans un chassé-croisé permanent des flux informationnels, entretenant par ailleurs la confusion : j’aurais été curieux de voir comment Terry Pratchett aurait pu traiter du thème des réseaux sociaux à partir du système des clics-clacs, parce que j’ai le sentiment qu’il l’avait anticipé, d’une certaine manière, comme il parle de c-commerce à uen époque où le commerce sur le net en me paraissait pas si développé que ça.
Mais plus prégnant, et beaucoup plus glaçant, c’est à la page 30 que j’ai pris un réel coup à l’estomac en comprenant que la motivation première de l’aristocratie morporkienne dans l’affaire centrale de La Vérité, c’est avant tout de lutter contre l’immigration, qu’elle fut économique ou non. Alors, certes, les nobles enrobent leurs pensées bassement xénophobes et espécistes, leur plan pour mettre un dirigeant plus digne à la place de Vétérini, de discours sur la tradition, la mémoire et la grandeur passée de leur cité, mais on comprend très vite à force d’absence de subtilité de leur part que le problème est tout autre. Et quand je les ai lu expliquer que leur priorité était finalement d’éviter que les humains deviennent minoritaires dans leur ville, j’ai pas fait le malin. Alors, certes, faire le parallèle entre une théorie pire que nauséabonde et terriblement contemporaine (aux ramifications que l’on connaît, malheureusement) et un roman publié il y a si longtemps n’est pas forcément pertinent. Mais je me dis que si, quand même. Parce que si on peut accorder à Terry Pratchett les qualités d’analyse sociologique dont il a fait preuve dans ses romans précédents, avec sa vision du racisme systémique par exemple, ou simplement l’acuité avec laquelle il exprime la lutte des classes, je pense qu’on peut aussi lui accorder une certaine lucidité sur les motivations de ceux qu’ils présente comme les antagonistes de son univers, et donc du nôtre.
« Nous cherchons toujours les envahisseurs en dehors de nos murs. Nous croyons toujours que le changement vient de l’extérieur, le plus souvent à la pointe d’une épée. Puis nous nous retournons et découvrons qu’il vient de l’intérieur de la tête d’un concitoyen qu’on ne remarquerait pas dans la rue. Dans certains cas, il s’avère commode de faire sauter la tête, mais on dirait qu’elles pullulent littéralement ces derniers temps. »
L’occasion sans doute de revenir sur le duo composé de M. Lépingle et M. Tulipe, antagonistes principaux de ce volume, dont j’avais un bon souvenir, assez déçu à la relecture, car finalement plus utiles au récit que réellement agréables, si cela fait sens. Alors certes, les antagonistes de Terry Pratchett sont quasiment à chaque fois des symboles, des vaisseaux de ses démonstrations à l’aune de ses romans, comme des reprises de tropes classiques et ce duo ne fait pas exception. Seulement, je dois admettre ne pas avoir été aussi satisfait que d’habitude par leur construction interne et leur participation à l’intrigue, plus faible que d’habitude, en tout cas plus expédiée, certainement ; ils n’étaient pas vraiment marquants, en tout cas pas aussi marquants que d’autres. J’insisterai donc plus volontiers sur ce que leur présence et leur existence-même à l’aune du récit suggère à mes yeux dans le logiciel Pratchettien.
La Nouvelle Organisation, comme ils s’appellent, ne sont rien d’autre que des mercenaires, de luxe, certes, mais des mercenaires. Ils illustrent parfaitement l’idée chère à Pratchett que le mal réside dans la banalité, qu’il n’y a pas besoin d’être intelligent ni de le planifier méticuleusement pour faire des dégâts. M. Tulipe et M. Lépingle, malgré leur arrogance et leur attitude hautaine, commettent erreurs sur erreurs à Ankh-Morpork, car venant de l’extérieur – on notera d’ailleurs cette ironie – pas accoutumés au fonctionnement ce cette si singulière cité. En y regardant de près, on comprend qu’ils n’avaient réellement aucune chance de parvenir à leur fin : leur plan est stupide, se déroule mal et ils ne parviennent jamais réellement à s’adapter pour corriger leurs fautes. Et pourtant, ils collectionnent les victimes et les gains au fil de leur mésaventure sans jamais sembler réellement craindre de conséquences regrettables pour leurs actes. Ils finissent pas réellement perdre à l’issue d’un incident de plus, à l’image du reste, mal préparés mais convaincus que tout finira bien, parce qu’ils n’arrivent pas à seulement concevoir le contraire.
D’une certaine manière, ils sont à l’image de l’aristocratie qui les emploie, tellement confits dans l’assurance qu’ils sont au dessus des lois et qu’il y aura toujours une solution de repli, que leur arrogance finit par confiner à la bêtise pure et dure. On revient encore et toujours à la vision de la noblesse de Terry Pratchett qu’il ne cesse de dérouler, avec à chaque fois un angle différent du précédent. Ici, La Nouvelle Organisation n’est finalement qu’une noblesse du crime, un avatar de ceux qui les ont missionnés, dont on se demande comment elle est parvenue à son niveau de réputation alors qu’elle n’est pas du tout à la hauteur de la tâche. Mais, comme à l’image de cette aristocratie, et notamment du rapport essentiel entre Guillaume des Mots et son père, ils sont une illustration supplémentaire de la notion de choix que j’évoquais plus haut, centrale au roman, que Terry Pratchett illustre au travers d’un de ses gimmicks, que j’appellerais sans trop d’imagination la nuance absurde.
« […] Je suis un inutile. On m’a éduqué pour ça. […] Notre principale activité, c’est de nous cramponner. Aux idées, surtout. »
L’exemple de M. Tulipe est sans doute le meilleur ici pour illustrer cette idée, encore plus en contraste avec M. Lépingle. Tout le long du roman, on lit que M. Tulipe, malgré son statut de grosse brute essayant toutes les drogues et autres saloperies non-identifiées qu’il peut ingérer, est un incroyable amateur d’art, au goût sûr et respectueux. Tout comme malgré son apparente absence de vice ou d’émotion, le Patricien abhorre viscéralement les mimes, autant qu’il adore son petit chien Karlou au point de nier son horrible odeur. Ou encore comme Otto Chriek, le vampire photographe de ce volume, est passionné par un art qui le tue, littéralement, à intervalles réguliers. Pour rendre ses personnages plus humains, Terry Pratchett les rend paradoxaux. Au delà de l’argument humoristique, je pense sincèrement que c’est une marque de fabrique qui fonctionne incroyablement bien. Comme chez Guillaume, par exemple, qui de toute évidence partage beaucoup des défauts de ce père qu’il hait, à entendre les gens qui travaillent avec lui, mais décident quand même de le suivre, parce qu’il lutte pour faire de ses défauts des qualités.
À partir de ce gimmick, en fait, Terry Pratchett dresse des portraits en creux, en quelque sorte anti-performatifs, en complément des méthodes littéraires classiques de description psychologique. En montrant ce que ces personnages ne font pas, plutôt que ce qu’ils font, il en montre autant sinon plus. On déteste M. Tulipe parce qu’on se rend compte qu’il aurait pu être tellement plus qu’une brute sans foi ni loi, tout en ressentant à l’occasion une réelle empathie à son encontre, là où M. Lépingle, par l’absence complète de cette nuance absurde, nous apparaît comme un complet et total salopard ne méritant aucune empathie. Comme, de la même manière, on comprend en creux que le Patricien, sous ses dehors calculateurs, n’est pas vraiment un tyran despote sans foi ni loi, même si de toute évidence il doit faire des choix difficiles et maintenir une apparence et un statut adéquat complexes.
À cet égard, Guillaume, malgré son éducation et ses réflexes aristocrates, par son choix de ne pas être son père, quitte à souffrir de pauvreté, est une bonne illustration de ce concept, allié avec l’idée systématique chez Pratchett que ses héros sont ceux qui apprennent et acceptent d’avoir tort. Lors de la première interaction entre Guillaume et Bonnemont, son futur chef imprimeur, il fait preuve d’arrogance et d’une forme de mépris, mais se corrige dès lors qu’il comprend qu’il n’est pas à la hauteur de la situation : il apprend, et ne cesse dès lors de le faire tout le long du volume, contrairement à son père, qui continue à agir comme si le monde lui appartenait encore, et surtout comme s’il avait la réponse définitive à l’énigme du monde. Comme le dit Otto Chriek au sujet de Guillaume, ce dernier fait de son mieux pour être quelqu’un de bien malgré une mauvaise éducation. Le Disque comme le monde tournent, et refuser de tourner avec eux, c’est l’assurance de se voir éjecter du manège par la force centrifuge des choses. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une bonne voie à suivre, mais qu’il faut certainement savoir identifier les voies sans issue.
« Marcher d’un même pas, c’est l’objectif du despotisme et de la tyrannie. Les hommes libres, eux, vont dans tous les sens. »
Clairement, une bonne fois pour toutes, l’analyse que je faisais à la conclusion du Dernier Héros, se confirme. La mutation du Disque est consommée ; on fait désormais plus confiance aux Alchimistes qu’aux Mages, et c’est sans doute une bonne chose, diégétiquement, certes, mais surtout narrativement. Ce tome n’est qu’une étape supplémentaire dans le renouvellement des enjeux et des concepts pour Terry Pratchett qui ici, comme à son habitude, sème des graines à cultiver par la suite. Otto Chriek n’est que le fer de lance de l’intégration nouvelle des vampires dans le paradigme Disquien, ruban noir sans complexe, intégré à la communauté qui l’aide à réfréner sa soif de sang, aidé notamment par les nains qui font désormais pleinement partie de la société morporkienne et font pour lui ce qu’on a fiat pour eux. On peut donc deviner que l’intégration des vampires, nécessairement différente de celle des nains ou des loups-garous, zombies et autres espèces du Disques, devra se faire selon des critères et méthodes nouvelles.
Avec l’introduction du personnage d’Henri Roi et l’établissement de son importance dans cette société pré-industrielle, on devine la continuation de l’ascension bourgeoise amorcée dans les tomes précédents, comme les prémisses du cycle du progrès auquel s’attèlera l’auteur dans le futur ; La Vérité a sans doute valeur de ballon d’essai, à certains égards. On y teste un nouveau casting de personnages qui ne durera pas au premier plan mais dont l’existence sera prolongée à l’arrière plan, rendant Ankh-Morpork encore plus vivante pour les tomes à venir. En établissant de nouvelles références avec lesquelles jouer sans avoir à narrer des intrigues entières, en soutien de celles qu’il faudra raconter, l’auteur renforce la complicité avec son lectorat. La malice de Terry Pratchett, c’est aussi d’intégrer à ses récits des histoires dont on a pas tous les éléments, comme le running gag du magasin de M. Hong, dont on ne sait rien en dehors de son statut de victime d’une terrible malédiction. De la matière à blagues et non sequitur, mais aussi à de nouvelles références communes sur lesquelles s’appuyer au delà de l’humour. Rendre le Disque toujours plus vivant dans nos imaginations, en dehors des lignes.
« Car rien ne doit rester définitivement vrai. Seulement le temps nécessaire, en vérité. »
En bref, un excellent tome des Annales, pour sa valeur militante et sociologique, une nouvelle fois, bien que pêchant sans doute un peu dans les registres des personnages et de l’intrigue à l’aune du standard Pratchettien habituel. On y établit beaucoup d’informations nouvelles de première importance tout en ménageant un espace d’indépendance essentiel en faisant un stand-alone absolument acceptable, mais évidemment meilleur avec le contexte de départ pleinement établi. Terry Pratchett ferraille avec ses armes de choix avec une maîtrise impeccable et prépare doucement le terrain pour les suites que l’on connaît, continuant à dérouler ses thèmes avec férocité et bienveillance, selon les enjeux traités ou le contexte.
J’aurais comme toujours aimé balancer encore plus de citations ou parler plus en détails de certaines séquences, comme par exemple les scènes de la pension de Mme Arcanum, des bijoux de concision comico-sociologiques Pratchettienne ; mais comme il le prouvait lui-même, la vie est une affaire de choix. Je fais celui de vous donner envie avec un peu de mystère, en tout cas je l’espère. Après tout, la pure découverte, c’est quand même une grande partie du plaisir.
Je vous laisse donc avec, tout de même, une citation du Patricien, parce que ce n’est jamais perdu, et qu’elle me paraît merveilleusement le résumer, comme elle résume une part essentielle et magnifique de la pensée de cet auteur merveilleux.
« Pour ce que j’en sais, tout finit mal. C’est dans la nature des choses. La seule solution, c’est de faire contre mauvaise fortune bon coeur. »
On se retrouve dans pas trop longtemps pour le prochain volume. Espérons que je ne procrastine pas trop, cette fois.
*WINK WINK*.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés