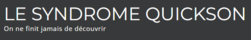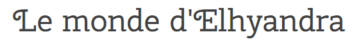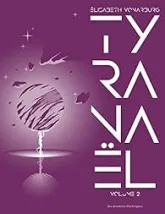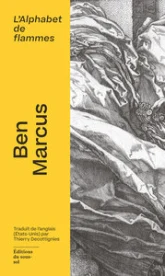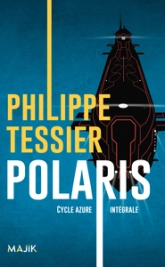Chroniques du pays des mères
Résumé éditeur
livré en 4 jours
l’avis des lecteurs
Chroniques du pays des mères est un roman d’Elisabeth Vonarburg, paru au Canada en 1992. Un roman qui est devenu un classique en imaginaire, par toutes les questions qu’il pose et aussi par sa structure particulière. C’est un roman que je voulais lire l’année dernière pour ma première participation au défi Un hiver au chalet, et que j’avais remplacé à l’époque par la quadrilogie Le royaume de Pierre d’angle de Pascale Quiviger. Alors cette année, c’était décidé : j’allais lire ce roman d’une autrice très certainement incontournable en SFFF. Je l’ai donc intégré dans la catégorie « Lire un roman québécois » du défi Un hiver au chalet.
Des chroniques historiques et philosophiques
Un roman ou des chroniques ?
Chroniques du pays des Mères porte bien son titre. Ce roman prend la forme de chroniques, entendues sous la forme d’annales, un recueil de faits rassemblés dans l’ordre chronologique. On suit la vie de Lisbeï, promise future Mère, dirigeante du Pays des Mères, mais dont le chemin prend une autre direction. On la voit grandir, évoluer, voyager, à travers un double mécanisme : sa correspondance écrite avec Tula, et le récit à la troisième personne du singulier dans laquelle elle s’intercale. Le roman n’est donc pas un récit lisse, linéaire et exhaustif de la vie de Lisbeï, mais plutôt centré sur des périodes marquantes de sa vie, lesquelles sont appuyées par sa correspondance qui illustre ses interrogations et ses réflexions. Cela fonctionne comme des zoom sur des moments de sa vie, parfois relatés au présent comme pour accentuer l’aspect « journalistique » de la chronique.
J’ai particulièrement aimé la manière dont la plume s’adapte à l’âge de Lisbeï. Très simple, naïve, pleine de questions enfantines au début. En cela, elle traduit nos propres questions face à ce monde inconnu. Très habile donc, de nous faire entrer dans cet univers de cette manière, dans l’esprit de Lisbeï enfante. Puis les réflexions de Lisbeï prennent de l’ampleur face aux enjeux du roman à la suite de ses découvertes. Alors, la plume se complexifie, alternant plus systématiquement récit et correspondance, comme si les deux finissaient par dialoguer ensemble et fusionner pour ne faire plus qu’une seule voix.
Un roman de réflexions
Cette construction n’offre pas au récit beaucoup d’action, comme si le recul avec lequel ces chroniques sont relatées se doublait d’un regard analytique et interrogateur. Le roman est un pavé de plus de 700 pages, autant dire que mon attention n’a pas toujours été constante. En revanche, le choix narratif permet au roman d’entrer dans une autre sphère. En effet, Chroniques du pays des Mères pourrait s’apparenter à une sorte d’essai politique, tant le roman interroge, réfléchit, questionne, la manière dont un peuple se (re)construit, sur quelles bases, avec quelle pérennité, quelle cohérence, quelle structure. Il interroge aussi le passé, le rôle et l’importance de l’Histoire, de la mémoire, et la manière avec laquelle on peut manipuler celles-ci pour construire le présent. Une excellente référence à glisser dans une copie de philosophie sur le sujet, donc.
Un roman de fantasy déconstruit
Adieu les codes classiques du genre
Dans Chroniques du pays des mères, qui est à mon sens davantage un récit de fantasy que de SF, tous les ingrédients traditionnels disparaissent. Tant ceux de fantasy que du roman en général.
En effet, on suit Lisbeï tout au long de sa vie, mais on ne peut pas vraiment parler de roman d’apprentissage, tant on n’y retrouve pas les codes habituels. D’ailleurs, Lisbeï a t-elle seulement un maître, un modèle qui l’instruit ? Elle n’est absolument pas dans cette position.
Il n’y a pas non plus cette figure de l’élue qui n’est rien mais qui va sauver le monde. Pas d’êtres surnaturels ou mythiques, pas de quête à proprement parler (à part celle très personnelle de Lisbeï, et très immatérielle, puisqu’elle va rechercher La Vérité, les sources du pays des Mères, et le roman s’interrogera alors sur ce qu’est la Vérité). Pas vraiment de magie, même si certaines pratiques comme la Taïtche peuvent y ressembler.
Et quasiment aucun rebondissement qui ne permettent pas vraiment d’identifier facilement les 5 étapes du schéma narratif habituel.
Un post-apo au ralenti
On est en revanche sur un roman post-apocalyptique. Il se déroule bien longtemps après le Déclin, qui a mis fin à notre monde contemporain tel qu’on le connait. S’en sont suivis plusieurs civilisations, guerres et luttes de pouvoir, avant d’instaurer une paix plus durable au Pays des Mères. Mais contrairement à d’autres romans post-apo que j’ai pu lire, la reconstruction est lente, et le savoir, l’ingénierie, les technologies d’aujourd’hui… semblent perdus.
La vie suit son cours, petitement, reconstruite autour de différentes cités (Béthély, Wardenberg…). A l’extérieur, des terres plus sauvages et polluées les environnent, moins connues et réputées pour héberger des renégates, des sauvages. Là habiteraient des peuples oubliés, et résideraient les traces archéologiques de la naissance de la civilisation actuelle. Malgré tout, la plupart des acteurs de ce roman n’ont aucunement l’envie d’aller en découvrir plus. Comme si le roman opérait un constant repli sur lui-même au lieu de s’engager vers des chemins pour l’élargir.
Des personnages et un langage au service d’une refonte sociétale
Des femmes et une langue féminisée
Le roman est construit sur une société matriarcale, dans laquelle le langage a été remodelé pour correspondre à cette nouvelle structuration sociétale. Les hommes sont peu nombreux et la société est construite sur des groupes d’âge, des couleurs (selon la capacité reproductive des individus), des familles et des lieux. Dans le roman, on raisonne davantage en couleurs qu’en genre ou sexe, d’autant que les mâles, tellement peu nombreux et inutiles en dehors de leur capacité de reproduction ne comptent pas vraiment comme tels.
Ainsi, la langue s’est-elle adaptée en conséquence. Une bébé, une enfante, une chevale; l’accord ne se fait plus au masculin qui l’emporte, mais au féminin. Il + elle = elles. Ca fait bizarre, d’abord. Et on se dit « mais quand même, c’est exagéré ». Oui, mais… non. La langue est l’outil des pouvoirs en place. Forcément, dans une société matriarcale depuis des lustres, cela paraît logique… Pourquoi on accorderait au masculin, sachant que les mâles n’ont pas de présence réelle ? On se rend compte alors que la langue véhicule, dans sa construction même, des indices sur la société qui la pratique : elle en dit long sur sa propre naissance et conception, mais aussi sur l’organisation sociétale en place.
Un roman anti-hommes ?
Pourrait-on dire que Chroniques du pays des Mères est un roman misandre ? Cette question s’est visiblement posée, comme le souligne Jeanne A. Debats dans sa préface, qui déroule d’ailleurs un par un les arguments détruisant cette idée.
Certes, les Hommes n’ont pas une belle place dans ce roman. Mais les femmes non plus. Les rouges (femmes et hommes) sont des ventres ou des distributeurs de sperme sur pattes qui ont la charge de repeupler la Terre d’enfantes. Finalement les seules qui ont une (relative) liberté sont les bleues, les stériles. Certes, le Pays des Mères semble englué dans une organisation matriarcale réduisant les hommes au statut de mâle reproducteur dépourvu de droits. En revanche, cette société est traversée par des voix progressistes (tendant à envisager autrement la présence et le rôle des hommes, à opérer une déconstruction de leurs points de vue et de leur manière d’envisager la société) qu’elle apprend à écouter.
Un roman à la recherche de l’équilibre
Ce renversement sociétal n’est ni misandre ni féministe. D’ailleurs je ne pense pas que le but de l’autrice était d’écrire un roman féministe. Plutôt de poser les jalons d’une réflexion sur les relations entre les genres (très binaires, mais bon, on est en 1992, pas une période très avant-gardiste sur ces sujets. Cela dit, il y a une vision de la sexualité assez novatrice dans ce roman). D’étudier la manière dont elles se construisent. Dont les mœurs peuvent évoluer (sur le long terme, comme on le voit dans le roman). Egalement la manière dont elles sont le reflet d’une Histoire et d’une mémoire; une construction. Elisabeth Vonarburg nous amène à nous pencher, par le biais de ce reflet négatif de notre monde, sur nos propres constructions.
C’était passionnant de voir comment les questionnements, les hésitations de certaines personnages ont pu contribuer à faire bouger les lignes, amener les autres à adopter un regard différent et à réaliser que non, ce fonctionnement n’était pas optimal ni juste. J’ai aimé que l’émotion, très absente de ce roman, provienne notamment de Toller, un des seuls à exprimer ses ressentis, ses sensations. On pourrait alors dire que Chroniques du pays des Mères est un roman qui met en scène la recherche d’un équilibre à tous les niveaux.
Chroniques du pays des mères est un roman d’Elisabeth Vonarburg, multi-primé et à raison. J’ai beaucoup aimé ma lecture, sans que ce soit non plus un coup de foudre; peut-être la faute à un texte très dense, réflexif, peu centré sur l’action ou même l’émotion. En revanche, j’ai apprécié ce cheminement auprès des personnages et m’interroger avec eux sur tous les sujets évoqués plus haut. Renverser les choses permet de se rendre compte de nos biais actuels, de s’étonner de choses qu’on trouvait jusqu’ici normales et de les considérer sous un autre angle. Une très bonne lecture, que je vais poursuivre avec la préquelle Le silence de la cité, qui revient sur l’époque juste après le Déclin.
Chroniques du Pays des Mères d’Élisabeth Vonarburg a été publié en 1992. Le roman a obtenu de nombreux prix et a été traduit en anglais sous le titre In Mothers’ Land. Cette traduction a reçu le prix spécial du jury du prix Philip K. Dick. Le roman a été acclamé par différents écrivains dont Ursula K. Le Guin et a atteint une grande renommée. Le livre a été édité en poche en 1996 puis est devenu par la suite très difficile à trouver. Les éditions Mnémos ont ainsi décidé de le rééditer en novembre 2019 et de l’accompagner d’une préface de Jeanne A. Debats.
Une société matriarcale
Le roman se situe dans le même univers qu’un autre roman de l’autrice, Le Silence de la cité mais plusieurs siècles plus tard. Une série de catastrophes et de désastres environnementaux ont ravagé la Terre. De nombreuses années après, la société se reconstruit et un pouvoir matriarcal plutôt pacifique a vu le jour. Mais une maladie inconnue a vu le jour, frappant les jeunes enfants. Les naissances de jeunes garçons sont également de plus en plus rares au point que ceux-ci sont élevés presque uniquement pour leur capacité de reproduction. La société est devenue féminine dans sa structure, sa hiérarchie et même son vocabulaire. Ces problèmes de fertilité ont entraîné une structure de la société assez particulière. Les « Mères » peuvent enfanter avec des mâles et sont choisies depuis leur enfance, suivant ainsi une éducation spéciale. L’insémination artificielle est également pratiquée.
Lisbeï est prédestinée à devenir « Mère » à Béthély mais elle va avoir un destin très différent que celui qui lui était prévu. La jeune femme que l’on suit depuis son enfance s’avère stérile et va choisir de partir explorer le monde plutôt que rester dans sa région natale. La vie de Lisbeï sera liée à l’histoire du monde, à la découverte de faits historiques et archéologiques. Le récit de sa vie est fait à la troisième personne mais également par le biais d’échanges épistolaires de différents personnages du roman et des journaux intimes de Lisbeï. Ce récit permet de comprendre les évolutions de la société et de connaitre les différentes régions. La connaissance du passé du monde reste parcellaire mais tout à fait crédible. Fait très important dans la société, le langage s’est adapté à la féminisation de la société. On attend par exemple une enfante, on monte un chevale. Élisabeth Vonarburg s’attache à décrire son univers habilement, en donnant un compte-rendu anthropologique de la société. L’univers décrit est vraiment unique, la société matriarcale qui est exposée a un fonctionnement et une religion qui lui sont propres.
Un roman porté par la réflexion
Au travers de l’histoire de Lisbeï, c’est un récit initiatique qui nous est conté, l’histoire de la reconstruction de toute la société par les femmes. L’autrice propose ainsi une réflexion sur le langage, sur les genres qui apparaissent liés à la culture, à l’histoire d’une société. Dans une société matriarcale, le langage devient féminisé au contraire de nos sociétés. Au travers de cette société qui est l’inverse de la notre, Élisabeth Vonarburg pointe du doigt l’absurdité de la domination, et déstructure une vision genrée des relations humaines. Elle nous offre ainsi un roman profondément humaniste, qui fait réfléchir à beaucoup de questions, un roman riche de renouveau et de questionnements.
Le ton du récit est mélancolique, c’est l’histoire d’une vie, d’une épopée. L’autrice prend son temps pour décrire son univers, ses personnages. Et c’est parfois trop long. L’histoire de Lisbeï est par moments longuette, elle s’écoule lentement. La religion a également une part assez importante dans le monde. La relation entre Tula et Lisbeï est belle, triste mais prend beaucoup de place dans l’histoire, alors que certains faits sont racontés parfois trop rapidement ou éludés.
Chroniques du Pays des Mères est ainsi un roman porté par la réflexion, par la découverte d’un univers miroir inversé du notre. Élisabeth Vonarburg décrit une société matriarcale et pacifiste par le biais du récit de la vie d’une femme dont le destin va être bouleversé. Des longueurs mais cela reste un beau roman avec de belles idées.
Le bonjour et la bienvenue dans un nouvel épisode de « Bob découvre des classiques exceptionnels avec beaucoup de temps de retard ».
Aujourd’hui… Vous avez lu le titre de la chronique, vous êtes pas trop bêtes, ça devrait le faire.
Ce bouquin et sa brillante réputation trainent dans ma PàL depuis 3 ans. Alors, pourquoi j’ai autant retardé l’inévitable, alors que normalement, thématiquement et génériquement on était dans ma zone de confort ultime ? Bon, déjà parce que 800 pages, hein, ne nous mentons pas ; je n’ai pas pour ainsi dire peur des gros pavés, mais n’empêche que quand un gros bouquin est un bon bouquin, c’est un réel engagement que de s’y mettre une bonne fois pour toutes ; surtout quand le gros pavé en question est absolument révéré dans la communauté et que comme moi, on aime pas trop l’idée même d’être dans la minorité. Quand on ajoute à ça un abandon un peu amer lors d’une tentative d’un opus plus modeste pour se mouiller la nuque, ça complique encore les choses. J’ai donc été, je n’ai pas peur de le dire, un brin pusillanime. Très joli mot, pusillanime.
Il aura fallu ma copine, plus courageuse que moi, et sa lecture extrêmement enthousiaste, plaçant ce bouquin dans ses ouvrages favoris de tous les temps pour me dire que mince, hey, quand même, il serait temps d’avoir les tripes un peu plus solides.
Et nous voilà aujourd’hui, maintenant que c’est lu, pour vous dire ce que j’en ai pensé, exactement.
Joie, alégresse et double ration de frites : on est bien sur un chef d’œuvre, pur jus.
Tristesse, amertume et endives braisées : j’ai beau dire « chef d’œuvre », il n’est pas dit que tout le monde pense à la même chose que moi en lisant l’expression que j’écris. Et il va falloir que j’explique ça aussi précisément que possible.
Parce que voyez vous, si je considère ce bouquin comme respecté tout à fait à raison, c’est avant tout pour des raisons techniques. Si j’ai absolument adoré ma lecture, ce n’est sans doute pas au premier degré, comme beaucoup des gens qui l’ont le plus apprécié, mais bien à une sorte de second degré. Ce qui, vous le devinez, n’est pas forcément aisé à verbaliser avec tout le tact et la précision souhaitable. Parce que mon motto pourrait très bien être « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. »
Mais je vous aime bien, alors j’vais essayer quand même de vous expliquer tout ça.
Une fois n’est pas coutume, faisons l’impasse sur le résumé, il serait au mieux insuffisant, au pire plus ou moins malhonnête en dépit de mes efforts. Disons très succinctement que nous y suivons Lisbeï, femme née au Pays des Mères, ce qui reste de la société humaine après ce qu’on devine être une apocalypse assez sévère et plusieurs siècles de troubles subséquents à cette dernière. On est, génériquement, dans ce que j’appellerais espièglement un post-post-apo : Elisabeth Vonarburg n’est pas tant là pour explorer l’après catastrophe que pour se servir des retombées de cette catastrophe comme d’un contexte de départ à un tout autre type d’exploration. Le Déclin qu’elle fait citer régulièrement à sa narration au fil de son récit n’est rien d’autre, à mes yeux, qu’un point de départ idéal pour installer ce qui l’intéresse vraiment, et ce qui nous intéresse aussi, par la même occasion : la société du Pays des Mères et son fonctionnement.
Et c’est ici que se niche un premier coup de génie de l’autrice de ce roman, à mes yeux, à savoir la création d’un paradigme diégétique entièrement détaché de celui de sa création. (La bête de phrase.) Ce que je veux dire par là, en moins péteux ; c’est qu’en dépit d’un monde clairement héritier du nôtre, Elisabeth Vonarburg réussit à faire de son Pays des Mères une entité entièrement autre, dont les conditions d’existence ne sont pas juste un reflet ou une exagération anticipatrice des dérives du monde dans lequel elle vivait au moment de la rédaction de son roman. En inscrivant très clairement son récit et une partie de ses événements les plus importants dans le temps long, en diluant de façon explicite et complexe les bouleversements ayant amené à la construction de la société de ses Mères telle qu’on la lit, l’autrice évite le piège de l’essentialisation.
Ainsi, là où on pourrait naïvement penser qu’un roman nous racontant une société matriarcale serait une utopie ou une dystopie ancrées dans des échelles de pensées réductrices, l’autrice fait le choix courageux – parce que très difficile – de brouiller les pistes à tous les niveaux, sans faire preuve de la moindre complaisance envers ses protagonistes, pas plus que de sévérité superflue. On trouvera donc de vrais défauts dans le modèle social du Pays des Pères, entre dérives incestueuses, eugénisme, système de classes discutable ou homophobie latente, surtout envers les hommes, clairement des citoyens de seconde zone dans cette organisation. Mais à l’inverse, on pourra aussi témoigner d’un système politique usant de contre-pouvoirs respectés, d’une certaine tendance au respect de l’auto-détermination, à des services publics efficaces, à un regard critique et introspectif de la part du système sur lui-même : le Pays des Mères est en paix et tourné vers le progressisme plutôt que vers le conservatisme en dépit de ses errements.
Sans doute très égoïstement, je dois bien dire que j’ai adoré ce portrait socio-politique parce que je lui ai trouvé un accent de vérité assez renversant ; si j’ai grincé des dents à la lecture de certaines scènes et idées exprimées par certains personnages de ce livre, je suis très vite redescendu. Tout simplement parce qu’Elisabeth Vonarburg, dans ce roman – attention, cascade de professionnel – fait à mes yeux la démonstration de la même idée que Robert A. Heinlein dans son Étoiles, garde-à-vous !, et sans doute même mieux que lui, consistant à penser que tout système moral construit par l’humanité découle nécessairement de son instinct de survie, et donc de ses conditions d’existence. Le Pays des Mères n’a pas les mêmes luxes que nous, ceux-là mêmes qui ne peuvent pas nous apparaître comme tels, puisque nous vivons avec depuis trop longtemps pour seulement les questionner. (Toutes proportions gardées, évidemment, je ne me leurre pas sur l’état de notre société et particulièrement celui des droits des femmes et des minorités. Monde de merde.) C’est pour ça que je parle d’appréciation au deuxième degré d’une bonne partie de l’histoire que m’a raconté Elisabeth Vonarburg ; je n’ai pas pu être aussi émotionnellement connecté que je l’aurais voulu à la trajectoire de Lisbeï – parce que je suis moi – mais j’ai été continuellement saisi par l’acuité du discours et de la construction de la démonstration fictionnelle de l’autrice, où rien ne tenait d’une vision idéalisée des femmes, mais au contraire d’une vision lucide de l’humanité réduite à une proportion essentiellement féminine, contrainte de s’adapter pour survivre à un monde hostile. Des choix imparfaits dans un monde imparfait : la citation clé du roman, sans le moindre doute à mes yeux.
Ce qui m’amène un peu maladroitement au deuxième point suscitant mon admiration pour le travail accompli dans ce roman : Lisbeï, son cadrage, et son articulation.
Moi qui suis un grand défenseur de l’idée qu’un roman doit tenir son unité de perspective sur toute sa longueur, je dois bien dire que j’ai été très séduit par le choix radical opéré par son autrice ; deux points de vue seulement, toujours tenus de la même manière. D’un côté, Lisbeï, et son point de vue seul, exprimé par un style indirect libre, et de l’autre, des échanges épistolaires permettant à l’autrice de ponctuellement sortir de sa perspective pour nous exposer des détails qui au moment de la chronologie de notre héroïne, lui échapperaient, et donc à nous aussi. Là encore, je trouve ça assez brillant. Déjà parce qu’en dépit de la narration à la troisième personne, ça nourrit vraiment notre empathie pour Lisbeï, enrichissant le récit de son point de vue sur chacune des situations qu’elle vit, réflexions mentales et interjections naturelles à l’appui, mais surtout parce que ça permet des ellipses impeccables et bien rythmées à l’autrice. On évite ainsi un bon paquet d’info-dumps qu’on aurait devinés très lourds et pénibles à passer, étant donné la richesse du passé historique et géographique de ces Chroniques. Alors certes, ça nous donne des lettres parfois un peu rigides dans leurs expressions, sans doute pas aidées par mon allergie à cette forme d’expression en fiction, de même que ça nous fait pas esquiver toutes les instances descriptives ou pédagogiques un peu indigestes qui émaillent le récit ; mais franchement, ça fait beaucoup trop bien le boulot pour que boude mon plaisir. C’est à la fois malin et efficace, et je dois bien dire que c’est un vrai plaisir de comprendre une telle astuce en parallèle de ma lecture, d’autant plus quand, à terme, l’autrice l’intègre encore plus fluidement à la narration de son récit, dans une intrication extrêmement élégante.
Et du coup, quand bien même, à un certain niveau, je trouve qu’il se passe pas grand chose dans ce roman, eh bah en fait il s’y passe tellement de trucs que c’en est presque épuisant. C’est bien simple, c’est rempli à ras bord d’idées et de dialogues philosophiques d’une portée sublimement riche. Entre les rappels subtils à la capacité bégayatoire de l’Histoire, à la réflexion constante sur les capacités et nécessités adaptatives de la civilisation, les rapports de classe, de domination ou d’influence, ou même plus simplement les rapports interpersonnels, c’est un peu sans fin. Et c’est assez fabuleux, je dois bien le reconnaître, même si j’ai du régulièrement lutter pour enchaîner plusieurs chapitres à la suite, tellement le bouquin est dense. (Une semaine après la première partie d’Anatèm, j’aime vivre dangereusement.) Si dense, d’ailleurs, qu’en réalité, je sais ne pas en avoir retenu grand chose en dehors de l’essentiel que je viens de vous livrer, sans doute parce que c’est ce qui m’a le plus marqué.
Ça et le fait que ce roman a l’intelligence suprême, lui aussi, de prendre son temps pour asseoir pleinement son propos, et faire souffler entre ses pages le vent de l’Histoire. Il n’y est pas question d’une destinée unique, d’un système à renverser par la force d’une seule personne embarquant une foule dans son sillage, il n’y est pas question d’une révolution, mais d’une évolution ; ce qui peut sonner nettement moins satisfaisant, quand on est habitué à une certaine construction scénaristique, mais qui demeure quelque part encore plus épanouissant. À l’image de la construction patiente de son univers, la structure de ce roman, dans son altérité brute et sincère, a quelque chose de reposant. Pas dans le sens d’une douceur faussement féministe, d’un Girl Power aussi fatiguant que fatigué, mais juste dans le sens d’une réflexion posée et argumentée, lucide et sage, et donc parfois un peu rugueuse. Parce que de la même manière que ses personnages s’interrogent sur leurs origines et positions sociales et culturelles, le roman dont elles font partie, à travers elles, lui-même s’interroge sur ses propres ascendances et potentielles descendances, avec une acuité implacable. C’est ça, je crois que je trouve le plus balaise, là-dedans : sans se donner l’ai prétentieux à aucun moment, les Chroniques du Pays des Mères contient sa propre histoire en même temps qu’une grosse partie de sa propre analyse, pour peu qu’on daigne, je crois, lui accorder l’attention nécessaire, par son simple souci du détail. Une forme de meta par procuration, sous-produit d’un livre monde complet.
Voilà. Là je crois que j’ai fait le tour. À peu près.
En voilà un roman qu’il est pas majeur pour rien. Quelle technicité, quelle précision, quelle histoire. Du grand œuvre à tous les niveaux, que je vais retenir longtemps. Que dire de plus. Rien.
Je suis content d’avoir été courageux.
Quatrième de couv’ :
Au Pays des Mères, quelque part sur une Terre dévastée du futur en train de se remettre lentement, les hommes sont très rares. Seules les Captes des Familles les Mères font leur enfantes avec les Mâles. Les autres femmes doivent utiliser une forme hasardeuse d’insémination artificielle.
Lisbeï et Tula ne s’en soucient pas trop : filles de la Mère de Béthély, elles grandissent ensemble, soeurs et amies. Mais Lisbeï se révèle stérile ; ne pouvant être la Mère comme elle en avait rêvé, elle doit quitter Béthély, et Tula.
Devenue « exploratrice », elle accomplira un autre de ses rêves : découvrir les secrets du lointain passé du Pays des Mères. Mais certains rêves sont difficiles à vivre…
Mon avis :
Depuis le temps que j’en entendais parler de celui-là :
- L’intrigue :
Lisbeï est une petite mosta de 5 ans, très isolée à la garderie jusqu’à l’arrivée de Tula qui va bouleverser son monde. Lisbeï et Tula seront fusionnelles et ce pendant plusieurs années jusqu’à la séparation obligatoire quand les fillettes grandissent. Lisbeï devait être la future Mère de Béthély mais son premier sang n’arrive pas et c’est un tout autre destin qui l’attend, dans la ville de Wardenberg.
- Le fonctionnement du monde :
On se trouve dans un monde matriarcal, les hommes naissent de manière très sporadique et n’ont d’autre office que celui de reproducteur. Les femmes s’occupent de tout dans les Familles (cités), exploitant la force des hommes pour des travaux très durs et encore.
Ces Familles ou Lignées, sont toutes dirigées par une Mère (ou autrement appelée Capte). En Litale, les Familles sont plus ou moins traditionnelles et croyantes dans la parole d’Elli et le monde est construit de façon à diviser les différentes catégories d’âges. Quand les femmes accouchent, leurs bébés partent directement en nurserie puis arrivés à un certain âge, les enfants descendent dans des garderies elles aussi divisées selon l’âge. A partir de 7 ans, on devient une dotta (fille) c’est la garantie que la mort infantile ne pourra plus survenir (ou presque). Cette séparation des mères et des enfants est expliquée par la très forte mort infantile, les femmes ont l’obligation de faire des enfants tous les 2 ans jusqu’à la fin de leur fertilité et on fait en sorte qu’elles ne s’attachent pas à ces enfants dont peu survivent. On apprend que certaines Familles appelées Progressistes seraient plus enclines à laisser la race humaine s’éteindre a contrario des Croyantes et des Juddites.
En plus d’une catégorisation par âge il y a celle des couleurs, en tant qu’enfant on est en vert, les humaines (hommes et femmes) en rouge sont celles qui sont fertiles et les bleues sont infertiles. Cette dernière couleur est finalement celle de la liberté où on est dégagé des obligations et où on peut faire des études pour explorer d’autres carrières de vie.
Dès l’ouverture du roman, on ne peut passez à côté du texte en lui-même dont la grammaire est entièrement tournée au féminin comme neutre, le coup est facile à prendre et ne pose aucune difficulté, j’ai eu la même interrogation pour les chevales au lieu de juments comme Lutin mais en y réfléchissant bien, je me dis que chevales permet un neutre réel alors que juments on n’imaginerait que…des juments… au final, comme quoi c’est bien trouvé ^^
- SF Féministe ?
Je dirai que…pas du tout….mais ça dépend du lieu.
Les femmes sont dans l’obligation de procréer jusqu’à ménopause ou mort en couche, ce n’est pas franchement féministe. Finalement, cette touche révolutionnaire vient de réflexions….d’hommes comme Dougall ou Toller qui n’ont pas le choix quand ils sont des rouges de partir de Famille en Famille pour la reproduction et de femmes comme Fraine qui s’insurge de ces enfants à faire au risque de sa vie. Lisbeï est stimulée aussi par ces échanges qui la font réfléchir au pourquoi les hommes ne sont pas dans des fonctions élevées alors que la parole d’Elli clame que toutes les humaines sont égales…ça vous rappelle quelque chose ? ^^
J’ai été ravie de gagner ce livre grâce à un concours organisé sur Twitter par l’éditeur Folio SF et le podcast C’est plus que de la SF, pour fêter la sortie en version poche ! En effet, j’avais beaucoup entendu parler de ce roman qui m’intriguait.
Plusieurs centaines d’années après « le Déclin », une société peu technologique s’est reconstruite autour des femmes, car à cause d’un mystérieux virus rares sont les garçons qui naissent. Cet univers très féminin, même dans le langage (le neutre est féminin et non plus masculin), met à l’écart les hommes et a réinventé une mythologie, une tradition et des préjugés. Dans un contexte où beaucoup d’enfants meurent jeunes de la Maladie, les femmes sont contraintes d’enfanter régulièrement, alors que nous sommes dans un matriarcat.
Lisbeï, élevée pour devenir Mère (cheffe d’une des Familles), se révèle stérile et voit sa vie bouleversée : contrairement à ses sœurs, elle a la liberté de partir et de se former dans une Famille accueillant un système universitaire. De nature curieuse et n’hésitant pas à se poser des questions, elle va très vite s’intéresser au passé qui la passionne.
Ce pavé est à la fois très dense et prend son temps : c’est toute la vie de Lisbeï qui nous est retracée, de son plus jeune âge à la garderie jusqu’à ses derniers instants. Ses interrogations et ses réflexions intimes nous en apprennent beaucoup sur un univers où l’Histoire a été construite par des mythes, mais qui évolue lentement et parfois avec réticence. Plus on avance dans le livre, plus on a envie d’avoir les réponses à des énigmes sur la formation de la religion et des coutumes figées, comme dans un roman policier où la victime serait la vérité.
Société plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord, le Pays des Mères se divise entre croyants plus ou moins extrémistes et progressistes parfois prudents, entre tradition et souhait de découvrir le passé et le monde, dans un contexte culturel où le désir de survie des Familles met la fertilité au-dessus de tout. La Maladie et ses variantes, l’obsession des Lignées, et la peur des zones polluées engendrent un environnement contraignant pour les êtres humains qui ont perdu la liberté de choisir leur destin s’ils sont fertiles. Le passé — réinventé — et ses conséquences sont souvent un frein à l’avenir de cette humanité rescapée.
Ce roman foisonnant est une vraie expérience de lecture qui offre des sujets de réflexion nombreux.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés