Imaginaire cyberpunk - 1
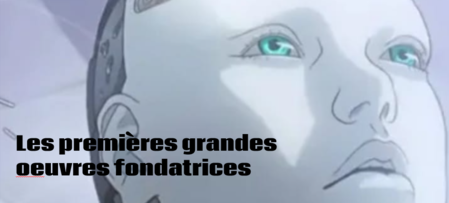
Un genre mutant, évolutif et visionnaire.
Le cyberpunk, sous-genre incontournable de la science-fiction, s'est imposé au fil des décennies comme un pilier de la culture populaire. Son influence s’étend bien au-delà de la littérature, touchant des domaines variés tels que le cinéma, les jeux vidéo, la musique, et même la mode.
Dès son émergence, il met en scène des futurs où le progrès technologique, loin de libérer l'humanité, tend à la soumettre à des systèmes oppressifs, qu'il s'agisse de corporations, de gouvernements corrompus ou de réseaux informatiques omniprésents. La technologie, dans l'univers cyberpunk, n'est pas un vecteur d'émancipation, mais un instrument qui exacerbe les inégalités, déshumanise les individus et aliène les personnages à travers le contrôle de leurs corps (cybernétisation), de leurs esprits (réalité virtuelle), et de leurs vies (surveillance et exploitation). Ces futurs anxiogènes auraient un caractère purement dystopique si le cyberpunk ne venait pas éclairer le présent de manière radicale.
Plus qu'une simple fiction, le cyberpunk se positionne comme un véritable laboratoire d'anticipation des dynamiques sociales à venir. En intégrant les avancées technologiques dans leurs récits, les auteurs capturent à la fois les angoisses et les promesses d’un techno-capitalisme émergent. Qui plus est, ils proposent des métaphores puissantes pour appréhender des processus abstraits tels que la cybernétisation de l’économie, la globalisation des flux d'information ou encore l’avènement de la posthumanité. Ainsi, loin d’être une échappatoire au réel, ce genre se présente comme une clé pour comprendre les bouleversements profonds déjà à l'œuvre dans nos sociétés. (1)
Une définition du cyberpunk.
Le terme « cyberpunk », popularisé par Bruce Bethke dans sa nouvelle Cyberpunk (1983), combine « cybernétique », la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine, et « punk », qui évoque une esthétique rebelle, anti-establishment, proche des contre-cultures des années 60 et 70. Devenu un mouvement, le cyberpunk a accordé une place considérable à l’informatique, à l’ordinateur, aux réseaux, au cyberespace, à l'IA, sans oublier l'invasion publicitaire qui caractérise ces mondes hyperconnectés. Puis est apparue une nouvelle conception de l’hybridation entre l’homme et la machine : celle de la connexion entre l’ordinateur et le système nerveux, de l’interface entre le vivant et l’électronique.
Le cyberpunk concerne essentiellement une description du futur proche et des améliorations technologiques (des implants cybernétiques, mais aussi des drogues ou médicaments) que l’être humain parvient à mettre au point pour augmenter ses capacités. Caractérisé par une ambiance sombre, cynique et violente, il met en lumière les dynamiques complexes d'une société globalisée et technologiquement augmentée, dans laquelle l'individu est écrasé par la puissance désincarnée des mégacorporations, si influentes qu’elles ont fini par remplacer les États. Le cyberpunk montre comment la technologie peut être réappropriée et détournée par les individus, souvent de manière ambivalente. Dans cet univers, hacker des ordinateurs est plus cool que d’être une star du rock. Les protagonistes sont des hackers, des geeks connectés en permanence, des dealers, des tueurs à gages, des zonards amateurs de rock, des yuppies déchus ou des rebelles, trop attachés à l'individualisme pour incarner de véritables révolutionnaires. Sur le fil du rasoir, ces antihéros évoluent en marge de sociétés dystopiques, souvent dans des environnements urbains denses et oppressants, voire dans des mégastructures, véritables villes dans la ville. La technologie, bien qu’omniprésente, ne sert que rarement le bien commun, aggravant les inégalités et créant des zones de non-droit où l'État est inexistant ou corrompu. La dégradation sociale y est exacerbée, tandis que les individus tentent désespérément de se connecter (sans que l'on comprenne toujours pourquoi) ou de transcender leur condition, parfois à tout prix.
Les récits cyberpunks spéculent sur l’avenir en s’appuyant sur des développements technologiques déjà en gestation lors de leur écriture. Les concepts de réalité virtuelle, de biotechnologie, d’intelligence artificielle et de piratage informatique, qui étaient avant-gardistes dans les années 1980, sont désormais des réalités ou des sujets de débats éthiques. Au fil des décennies, le genre a su s'adapter aux transformations technologiques et sociétales.
Les premières grandes œuvres fondatrices.
Bien qu'ayant émergé dans les années 1980, le cyberpunk s'enracine dans des récits plus anciens. Parmi eux, on pourrait citer Simulacron 3 (1964) de Daniel F. Galouye et Sur l’onde de choc (1975) de John Brunner, qui est parfois considéré comme étant le premier roman cyberpunk, bien que son auteur le réfute. Toujours est-il que Philip K. Dick apparaît a posteriori comme l’un de ses maîtres incontestés. Dès 1968, avec Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, Dick aborde des thèmes tels que le clivage du moi et l'aliénation du héros, incapable de nouer des relations normales avec les autres. Ce roman, adapté en film sous le titre Blade Runner (1982), a anticipé de nombreux éléments caractéristiques du genre : un futur sombre et déshumanisé, où la vie urbaine est oppressante, polluée, et dominée par des mégacorporations, des androïdes ignorant leur nature artificielle grâce à des souvenirs factices, et la quête d'identité à l’ère des machines.
L’œuvre de William Gibson, Neuromancien (1984), est souvent considérée comme le véritable point de départ du cyberpunk. Ce roman visionnaire introduit des concepts tels que le cyberespace – préfigurant ainsi l’internet et la réalité virtuelle – et les intelligences artificielles autonomes. Neuromancien plonge dans un univers où des hackers naviguent dans des réseaux virtuels aussi dangereux que réels, tandis que des mégacorporations dictent le sort des individus. Ce roman définit l’esthétique du cyberpunk et ouvre la voie à de nombreuses œuvres ultérieures. Aux États-Unis, Neuromancien a été perçu comme à la fois hostile à la technologie et pessimiste, mais Gibson ne se reconnaît dans aucune de ces deux visions.
"La « trilogie Neuromantique » n’a pas simplement révolutionné la science-fiction et marqué l’apparition d’un grand écrivain, elle a aussi, sans doute, façonné le réel dans lequel nous vivons. En mettant en image et en nommant les échanges de données informatiques sur des réseaux encore balbutiants à l’époque de rédaction, William Gibson a fait acte de magie et créé notre présent. Il ne l’a pas prédit : il l’a inventé. Et en cela, il est grand." Laurent QUEYSSI - Première parution : 1/10/2019 Bifrost 96 - Mise en ligne le : 27/11/2023
Avec Schismatrice (1985), considéré comme l'un des textes fondateurs du cyberpunk, Bruce Sterling contribue de manière décisive à la structuration du genre. Sommet de son œuvre, ce roman-culte aborde avec brio des thèmes centraux de la science-fiction moderne tels que le clonage, les humains transgéniques, les cyborgs, les intelligences artificielles, les extraterrestres, la posthumanité et l'immortalité. Sterling publie également une anthologie-manifeste, Mozart en verres-miroir (1986), dans laquelle il décrit le cyberpunk comme « l’imbrication d’univers auparavant dissociés : le royaume de la technologie de pointe et les aspects modernes de l'underground pop. »
"Les œuvres des cyberpunks trouvent leur parallèle dans toute la culture pop des années 1980 : dans les vidéos rock, dans la marginalité cibiste et informatique, dans les discordances baladeuses du hip-hop et du rap... Certains thèmes centraux resurgissent fréquemment dans la S-F cyberpunk. Celui de l’invasion corporelle : membres artificiels, circuits implantés, chirurgie esthétique, altération génétique. Ou même, plus puissant encore, le thème de l’invasion cérébrale : interfaces cerveau-ordinateur, intelligence artificielle, neurochimie — techniques redéfinissant radicalement la nature de l’humanité, la nature du moi." (Cf. in Bruce Sterling).
Le groupe des cyberpunks réunissait de fortes individualités : William Gibson et Pat Cadigan qui continuent d’explorer le futur proche et le thème ambivalent de la réalité virtuelle, Paul Di Filippo, Walter Jon Williams (Câblé) qui s’est éloigné des motifs neuromantiques pour explorer d’autres territoires (Sept jours pour expier, Plasma), Lewis Shiner. L’auteur le plus intéressant de cette génération cyberpunk est sans conteste Greg Bear, avec La reine des anges, un pur chef-d’œuvre de cette mouvance." Jacques Baudou, in La Science-fiction, PUF, " Que sais-je ? ” no 1426, 2003
Le réalisateur et scénariste Paul Verhoeven n’avait jamais fait de science-fiction avant RoboCop. Le titre original était quelque chose comme Futur of Law Enforcement, et quand il a vu que c’était à propos d’un robot, il a dit non. Mais après avoir relu le script, il a accepté. RoboCop (1987) mêle science-fiction et satire sociale pour aborder la militarisation de la police, les dérives capitalistes et les questions d'identité à travers l'histoire d’un policier devenu cyborg. C'est une satire mordante d'un capitalisme débridé, où l'humain est sacrifié sur l'autel du profit, offert en pâture au dieu Dollar. Miroir à peine déformé de la société de son époque, et peut-être encore plus pertinent aujourd'hui, ce film choque toujours par son audace. Son ton libre, empreint d'un cynisme cinglant et d'un humour noir rarement vu à Hollywood, provoque autant de rires que de malaises. Même les scènes les plus violentes parviennent à faire sourire, grâce à des sous-entendus subtils, jusqu’à un final absurde et grotesque, véritable pied de nez au spectateur. Mais RoboCop va bien au-delà de la simple critique sociale. Il offre une relecture tragique du mythe de Prométhée, dépeignant le destin d’un homme qui a tout perdu, y compris son humanité. Pris dans un conflit intérieur, ne sachant plus s’il doit se considérer comme un être à part entière ou comme un simple produit déshumanisé, il incarne une réflexion poignante sur l’identité. Cette interrogation fondamentale – la machine a-t-elle une âme ? – fait écho à Blade Runner, sorti quelques années plus tôt, réaffirmant la place centrale de cette question dans le paysage cyberpunk.
"Dopé par la signature irrévérencieuse du Hollandais violent, Total Recall (1990) regorge également d’ingrédients typiques du cyberpunk : le fameux conglomérat de sociétés malfaisantes, Quaid le protagoniste (ici amnésique) en proie à une crise existentielle, la violence à la limite du grand-guignolesque, les corps pétris de prothèses multiples, la rébellion contre l’ordre établi, des technologies plus sidérantes les unes que les autres. Le génie de Verhoeven dans ce long-métrage – l’un de ses plus virtuoses – est de partir d’une réalité banale et routinière (bien que située dans un futur où la planète Mars est colonisée et exploitée) avant de glisser progressivement vers la hard science-fiction. Dès qu’il lève la tête de son quotidien, Quaid ne voit que des murs saturés d’écrans publicitaires. Tant et si bien qu’il finit par répondre à l’une d’entre elles et accepter l’offre de la société Rekall, spécialisée dans l’implantation de souvenirs factices." (2)
Vous trouverez la suite de l'article sur Dolpo avec " de Arika à Cyberpunk2077"
Cet article a été rédigé par l'équipe du blog "Inventer l'avenir" et repris sur notre site avec leur aimable autorisation.
Pour retrouver leur site, cliquer ici