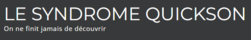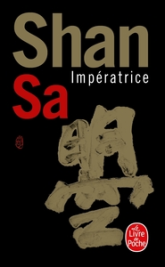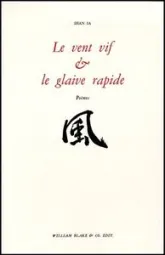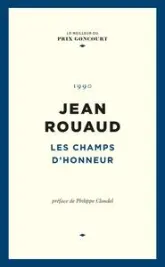La joueuse de go
Résumé éditeur
livré en 4 jours
l’avis des lecteurs
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il me semble vital de régulièrement sortir de sa zone de confort, au moins de manière ponctuelle. Au delà de se confronter à des choses qu’on connait peu pour bousculer ses habitudes autant que ses préjugés ; il s’agit aussi de trouver des feux nouveaux auxquels forger son esprit critique, une nouvelle façon d’aborder ce qu’on aime et n’aime pas.
Dans le cas précis de La joueuse de go, j’abordai ma lecture de façon extrêmement optimiste, le roman étant auréolé d’un consensus positif et d’un statut de classique malgré sa relative jeunesse aux yeux du public. Et étant donnée ma conception toute personnelle de ce statut, j’étais assez enthousiaste à l’idée de pouvoir me joindre aux chœurs dithyrambiques et prouver que je n’étais pas juste un esprit chagrin adepte de l’esprit de contradiction en quête de polémique pour le simple plaisir de flatter mon ego.
Or, il s’avère que j’ai absolument détesté cette lecture, comme peu d’autres avant elle à l’échelle de ma vie de lecteur. Sans aucun doute le roman que j’ai le moins aimé lire depuis que j’ai lancé ce blog ; en dehors d’Ajedhora, mais pour des raisons tellement différentes que j’estime que ça ne compte pas vraiment.
Il s’avère que ce roman précis cristallise tellement de mes raisons habituelles de détester un roman que paradoxalement, il valide entièrement mon ambition de ne plus abandonner aucune de mes lectures en cours de route, dans l’optique de ces chroniques. Ironiquement, je pourrais même envisager que celle que je m’apprête à rédiger puisse être une des plus intéressantes que j’aurais jamais à écrire, car elle me donnera l’occasion de préciser beaucoup de choses quant à mes goûts et ma vision des choses vis-à-vis de la littérature en général. Et même, je crois, d’en extraire des réflexions que j’espère intéressantes.
Bien que je m’apprête à être parfois abrupt, ce sera avant tout par souci d’honnêteté. Il ne s’agira pas de descendre gratuitement le travail de Shan Sa, qui mérite mon respect au même titre que tout travail littéraire ayant été capable de fournir un ensemble cohérent et signifiant ; c’est bien le cas ici. Il s’agira seulement d’expliciter au mieux mes griefs envers un travail que j’estime simplement être aux antipodes de ce que je considère comme mes idéaux littéraires, de montrer précisément les limites auxquelles se confronte trop souvent la littérature générale pour pouvoir me parler autant que l’Imaginaire. Ou du moins une certaine conception de la littérature par rapport à celle qui sait plus souvent me toucher.
Mais trêve d’introduction.
Ce récit se déroule durant l’invasion de la Chine par le Japon, et suit en parallèle les parcours de deux personnages. D’un côté, une jeune chinoise aux mœurs libérales peu compatibles avec la culture séculaire de son pays et de sa famille, rêvant d’autres choses que ce qui semble lui être promis ; et de l’autre un soldat japonais parasité par sa propre culture et ses idéaux de grandeur, luttant avec ses démons intérieurs autant qu’avec les rebelles chinois luttant contre l’invasion de leur pays.
Commençons par l’évidence, ce qui m’a sauté aux yeux ; ces deux personnages me sont terriblement antipathiques. Du moins, les efforts fournis par l’autrice pour les rendre humain·e·s et appréciables n’ont pas fonctionné sur moi. Je crois avoir deviné une sorte de construction en « yin-yang » entre les deux, avec notre jeune Chinoise (qui n’est pas nommée) représentant le côté le plus lumineux du duo avec quelques touches d’ombres, et notre soldat japonais complétant le tableau par sa noirceur, avec quelques touches de lumières. Mais si l’intention me paraît claire, la réalisation n’est malheureusement pas aussi limpide. La faute principalement à une construction textuelle éclatée, alternant les chapitres comme les analepses qui leur sont consacrés à un rythme bien trop effréné, ne dépassant jamais les quatre ou cinq pages, ne nous laissant jamais vraiment le temps de nous imprégner de leurs motivations ou de leurs caractères ; nous laissant seulement avec les événements eux-mêmes comme témoins de leurs personnalités, manquant cruellement de souffle.
De ce fait, on se retrouve quasiment systématiquement à devoir juger de leurs actions hors de tout véritable contexte ; la très relative malédiction de leurs naissances et des contingences tragiques dont iels sont l’objet ne suffisent pas à créer l’empathie. Au contraire, iels s’en proclament victimes en permanence sans réellement fournir le moindre effort pour s’en sortir. Si encore iels avaient dû en souffrir après avoir essayé quelque chose, j’aurais pu éprouver un peu de compassion ou de compréhension. Mais si je puis volontiers admettre que ce soit un défaut de caractère de ma part ; lire des gens se plaindre en permanence de subir des circonstances tragiques tout en vivant relativement confortablement sans rien réellement tenter pour changer ces circonstances me laisse froid.
Même parler, communiquer, semble au dessus de leurs forces, toujours paralysé·e·s par les enjeux ou quelque terreur intériorisée qui ne peut pas se justifier par leur culture ou les mœurs, puisque ces dernières ne semblent pas vraiment les gêner le reste du temps. La tragédie n’est alors pas tant leur histoire que l’histoire dans laquelle ces personnages se retrouvent piégés par l’autrice. Car très vite, on sent bien que quoiqu’il arrive, le récit tend d’abord vers sa conclusion, prédéterminée, et non pas vers sa réalisation ; ce qui, là encore, empêche toute réelle empathie. Tous les méandres de ce fleuve ne peuvent avoir qu’une seule destination, et on se retrouve à devoir suivre son cours à allure forcée, sans pouvoir espérer en découvrir les berges. Tout étant vu et vécu au travers de ces deux prismes plus souvent égocentrés et désagréables que l’inverse, on se retrouve très vite à juste attendre que ça se passe, traversant des écueils classiques, même pas ému·e·s par les éclaboussures. Il y a évidemment ici une question de sensibilité, mais j’ai personnellement été très vite sorti du récit ; non seulement par mon manque d’identification à ces deux personnages, mais aussi et surtout par l’usage du style par l’autrice.
Et là, on attaque un terrain très personnel. Mais je serais presque reconnaissant à Shan Sa de me fournir avec ce texte un exemple aussi parlant de ce que je considère comme l’arnaque conceptuelle qu’est le style. Comprenons-nous bien ; Shan Sa écrit bien, je dirais même très bien. Mais elle commet dans ce texte une erreur cardinale à mes yeux, à savoir oublier que ses personnages ne sont pas des écrivain·e·s. Or, ce récit est focalisé à la première personne, pour les deux narrateurices. Si une partie du roman s’en ressent sans mal, avec un déroulé relativement sobre, tant dans les descriptions que dans les flux de conscience, on se frotte très vite à un écueil terrible pour moi.
Car si je n’ai pas de problème avec les envolées lyriques, les formules joliment alambiquées ou travaillées à l’occasion, ou encore les séquences oniriques détachées du réel ; j’ai beaucoup plus de mal avec le fait que ces dernières puissent créer une rupture de cohérence avec le reste du récit. Car à ce moment-là, je me retrouve éjecté de ce dernier, avec le sentiment que l’auteurice se pose devant son œuvre avec un signe au néon pour signaler sa présence et son talent pour faire de jolies phrases. À ce moment-là, le style devient une fin en soi, et non pas un outil au service du récit, et c’est pour ça que j’ai de tels blocages avec, étant devenu à mes yeux un alpha et un oméga très surfait de la littérature en France. Que ce soit « bien écrit » ne fait pas tout, il s’agit de bien articuler ce qui est bien écrit, que cette « beauté » soit signifiante, et cohérente avec les ambitions avec ce qui est raconté.
Et c’est là que le bât blesse plus que le reste à l’aune de ce récit pour moi. Car sa volonté esthétisante rentre, pour moi, en directe contradiction avec ce qu’il raconte. Ce roman est rempli de choses terribles, terriblement euphemisées par ce langage élégant. Il est bien possible que les 20 ans passés depuis sa publication aient joué en sa défaveur, notamment à cause de sa façon d’aborder un certain nombre de sujets problématiques, à savoir le viol, le mariage forcé, la domination patriarcale ou les conflits inter-culturels ; ce que je peux concevoir. Cependant, je crois que même sans la distance des années, les considérations sexistes et essentialisées par les deux personnages sont encore plus violemment datées. Et si j’ai songé à l’idée que ces considérations soient un témoin de l’époque du récit plutôt qu’un signe d’une compréhension maladroite ou vieillotte des rapports hommes-femmes, je crains qu’encore une fois la cohérence du récit soit écornée, puisque nos deux personnages sont souvent capables de faire la part des choses à propos de choses aussi complexes, aspirant plus souvent qu’à leur tour à considérer les choses de façon moins simpliste que la société le voudrait.
Je me retrouve donc dans une situation complexe. Parce que je crois sincèrement que le roman se démène pour dénoncer ce qu’il raconte d’horrible, atténuant le choc traumatique par la douceur d’instant privilégiés entre nos deux personnages principaux (le go du titre) ; parvenant à de rares moments à exprimer un point de vue moral auquel je pouvais adhérer. Mais ces instants ne suffisent pas. D’abord parce que j’ai trouvé ces deux personnages assez infects, comme je vous l’ai déjà dit ; je crains que Shan Sa compte trop sur une adhésion et un attachement par principe, oubliant de travailler leurs qualités avant de les nuancer par leurs éventuels défauts. Lâches, égocentriques et lymphatiques, parfois cruels, se laissant trop souvent porter par les événements pour se plaindre des conséquences ensuite dans un ton mélodramatique du plus mauvais effet. À l’image d’ailleurs des dialogues, où les personnages s’expriment très souvent dans un langage extrêmement précieux, y compris lorsqu’ils sont ivres, et ce peu importe leur niveau d’éducation. Il ne s’agirait pas de les faire jurer comme des charretiers ; mais les entendant dans ma tête en les lisant, je perdais énormément en sentiment de naturel, en souffle, et donc en immersion. Si on me présente des gens simples, je m’attends à ce qu’ils parlent simplement ; pas à ce qu’ils dialoguent au passé simple. Si j’étais de mauvais esprit, je dirais qu’iels se prennent un peu trop au sérieux, oubliant leur médiocrité à l’échelle du roman et de leur environnement ; je ne saurais alors dire si c’est leur faute ou celle de leur autrice.
Il ne s’agit pas de juger les ambitions de cette dernière, encore une fois. Je n’ai aucune réelle idée de ce qui l’a poussée à écrire ce roman, ni de cette façon précise. Ce que je sais, c’est qu’en tant que lecteur, je puise une partie de mon plaisir à voir un travail littéraire se dérouler sous mes yeux avec cohérence ; et c’est ce qui m’a en grande partie manqué pour justement prendre du plaisir durant cette lecture. Mon problème n’est pas tant de lire un personnage parler d’une façon bien trop soutenue pour son supposé niveau d’expression ; mais de le lire changer de registre au gré des besoins du récit, me faisant me rappeler à de trop nombreuses reprises que je suis en train de lire un livre à défaut de vivre sa lecture en oubliant la réalité le temps de quelques heures.
Et c’est là que ce que je considère comme une obsession de la forme en dépit du fond m’horripile profondément, car je me retrouve non pas à lire un roman par un·e auteurice, mais un·e auteurice qui a écrit un roman. Les efforts de style, ponctuant le récit de phrases grandiloquentes, sonnant parfois creux malgré leur élégance, viennent à mon goût parasiter le récit par leur incongruité. Sans compter qu’elles expriment souvent les sentiments des personnages comme des vérités générales, appuyant encore un peu plus le sentiment de malaise que je pouvais parfois ressentir à lire ces excroissances sur un récit globalement plutôt lisse ; elles sortaient de la diégèse pour me pointer du doigt des déclarations avec lesquelles j’avais du mal à être d’accord. J’aurais eu du mal à compter le nombre de soupirs et de regards au ciel qui ont émaillé ma lecture (sans évoquer cette fascination hallucinante pour le sexe qui traverse le roman et que comme souvent dans ce genre de lecture, je n’arrive pas à m’expliquer).
Je pense avoir compris l’essentiel du roman. Je ne suis juste pas d’accord avec son constat pessimiste, tragique, quasi nihiliste, plaquant sur l’humanité des analyses très générales, essentialisant une trop grande partie des enjeux qui l’animent. J’aurais adoré me prendre de passion pour ses personnages s’il n’avaient pas été si contraires à mes valeurs ; tout comme j’aurais adoré m’extasier devant les efforts stylistiques de son autrice si je ne les avais pas trouvés si vains et discordants avec l’atmosphère qu’elle tentait d’instiller à son récit. L’esthétique n’est pas ma priorité lorsque je lis, et je conviens bien volontiers que ma lecture analytique, très politisée, a probablement gâché une bonne partie de cette découverte ; Shan Sa paie sans doute, bien malgré elle, le prix d’une politique de publication francophone faisant la part trop belle à ce damné style depuis des décennies.
Si j’aime tant l’Imaginaire, c’est aussi parce que j’aime sa capacité à me renvoyer un reflet de mon monde déformé par la distance de la fiction et de l’altérité. Ce récit paie sans doute, aussi, son ancrage trop prononcé dans notre monde à coup de références historiques alourdissant le récit et de frontalité dans l’évocation de ses problématiques. Tout ça ne m’a, en soi, rien appris de nouveau ni ne m’a fait me poser de questions que je ne m’étais pas déjà posées à d’autres occasions, et avec bien plus de satisfaction ou de résultats. Si j’avais dû le lire il y a quinze ans, j’aurais sans doute eu un retour bien plus enthousiaste.
Seulement voilà, mon expérience et mes exigences de lecteur ne sont plus les mêmes qu’il y a quinze ans.
Le constat est aussi amer qu’implacable : ce roman et moi n’étions pas faits l’un pour l’autre ; c’est tout.
Tout comme il me faut constater pourquoi ce terme de classique qui ne cesse de faire débat me gène tant. Car sans préjuger des intentions de cette partie du monde littéraire qui semble faire autorité sur le reste au nom d’une légitimité que je qualifierais diplomatiquement de discutable ; force est de constater que je ne m’y retrouve pas. Un « classique » se définit d’abord et avant tout par la validation dont il fait l’objet, au nom de critères aussi fugaces que sa renommée ; si on ne se retrouve pas dans cielles qui font ces critères ou dans ces derniers, peu de chances de se retrouver dans ces classiques, forcément. Je n’aime pas ce terme pour ce qu’il induit de norme de goût dans un domaine où nous avons la chance de pouvoir en avoir littéralement pour tout le monde, comme s’il existait une ligne éditoriale cosmique suprême depuis la nuit des temps sur laquelle nous devrions nous disputer éternellement jusqu’à enfin la trouver et ne plus en bouger, jamais.
Un classique, selon moi, devrait n’être qu’une notion purement subjective dont nous devrions rediscuter les termes à chaque échange, selon nos perceptions et nos attentes propres, à l’aune des genres ou des contextes de leurs créations ; car puisque nous sommes tou·te·s différentes, pourquoi nos bouquins ne le seraient-ils pas, de même que nos parcours de lecteurices ?
Et si j’utilise le terme de classique, parfois, de façon un peu décomplexée, c’est par souci de créer un lien avec les gens qui me lisent ou avec qui je discute, sur la base d’une notion commune quoique imparfaite, avant d’essayer de déconstruire le terme au sein de mes critères d’appréciation. Il s’agit parfois de simplement le remplacer par un autre plus à-même de rendre justice aux qualités que je lui prête : pionnier, défricheur, inventeur, conceptualisateur… Car un classique n’est jamais rien d’autre qu’un épiphénomène au même titre que tous les ouvrages qui n’en sont pas ou n’en sont plus ; ils ont juste bénéficié d’un temps de vie plus long dans l’inconscient collectif, parce qu’ils savaient exprimer quelque chose de leur zeitgeist, ou d’intemporel, « mieux » que les autres ; aux yeux de cielles qui avaient ou ont ce pouvoir de validation. Derrière, il ne s’agit que de faire pérenniser cette contribution ou non, ou de mettre de côté, relativiser les enseignements qu’on n’estime plus à même de correspondre aux nouveaux critères émergents.
Je ne doute pas un seul instant que La joueuse de go ait pu exprimer un sentiment général de la meilleure des façons lors de sa sortie, mais aujourd’hui, le compte n’y est pas à mes yeux ; contrairement à d’autres romans sortis plus tôt ou plus tard, avec plus d’inventivité ou un sens plus efficace de la frontalité ou du lyrisme.
Maintenant, on oublie ce mauvais moment, et on passe à autre chose, sans renoncer à l’idée de faire des efforts pour sortir de sa zone de confort. Au mieux on fait de belles découvertes, au pire ça tanne le cuir.
Et une lecture commune, une! Qui plus est un book club!
L’histoire
Place des Mille vents une lycéenne Mandchoue a l’habitude de jouer au go. Seule femme au milieu des hommes, elle est un fin stratège et c’est à ce titre qu’elle est acceptée.
Au Japon, lui, jeune homme de 20 ans, s’est engagé dans l’armée pour conquérir la Chine. Guerrier adroit et courageux, il s’élance à la conquête de ce nouveau pays.
Ces deux personnages seront réunis le temps d’une longue partie de go tandis que les révolutionnaires tentent de freiner l’avancée japonaise, multipliant les actes terroristes. Ils ignorent tout l’un de l’autre. Elle est une femme, il est un homme; il est Japonais, elle est Mandchoue; il est dans l’armée et traque les rebelles, elle tombe amoureuse de l’un des révolutionnaires. Tous les oppose et pourtant ils se comprennent à travers le jeu de go.
La Joueuse de go est un roman que je voulais lire depuis longtemps. Grâce à cette lecture commune, j’ai pu découvrir un auteur plein de talent et une oeuvre remplie de poésie.
L’intrigue se noue lors de la conquête de la Mandchourie par les Japonais. Ces derniers veulent destituer l’empereur et s’approprier ses vastes territoires. La tâche n’est pas facile: l’hiver est rude et les Japonais souffrent du froid. Le mauvais temps ne les empêche pourtant pas de piller et tuer à tout-va. Un jour, l’unité du personnage masculin principal s’arrête dans une ville appelé Mille-Vents. Le narrateur masculin prend la parole pour raconter son ennui à la caserne mais aussi son envie d’en finir en plus vite. Certes, le combat est une chose qui le grise. A chaque fois qu’il prend la parole c’est pourtant pour se confier. Au fur et à mesure du récit, il raconte son amour pour une jeune Geisha. Amour malheureux qu’il cherche à tous prix à retrouver à travers d’autres femmes telles les prostituées du quartier des plaisirs. Ces confidences sont entrecoupées par celles de la lycéenne. En effet, Shan Sa a su tisser un roman où deux voix se mêlent jusqu’à ce qu’elles se rejoignent.
La « joueuse de go », elle, se partage entre son collège et le go. Jeune fille de bonne famille, elle ne connaît pas grand chose à la vie. Un jour, pourtant, elle est prise malgré elle dans le flux d’une manifestation. Elle tombe. Un jeune homme la relève. Il s’agit de Min, un jeune révolutionnaire. L’auteur décrit avec brio la fulgurance de l’amour qui naît entre la narratrice et Min. Elle devient une femme dans ses bras et découvre le désir. Mais si la jeune femme s’abandonne dans les bras de son amant, elle reste lucide sur sa condition. Elle n’est qu’une gamine. Pourtant, l’auteur nous laisse entrevoir ici l’esquisse d’une femme moderne qui ne sait compter que sur elle-même, qui privilégie les études et l’indépendance au dépens mariage. A plusieurs reprises, elle exprimera ses idées face à ses amies ou même face à sa soeur, mariée et trompée mille fois par son mari.Elle se révèle être une femme de caractère, n’hésitant pas à défendre ses idées.
Quand ces deux personnage se retrouvent, les points de vue alternent. Ainsi nous sommes confrontés aux mêmes scènes mais vues différemment. Les deux personnages s’affrontent lors d’une mémorable partie de go. Le jeu devient le troisième personnage du roman. En effet, il permet de révéler le caractère des joueurs. Quand la joueuse de go se sent bien, elle joue rapidement et attaque son adversaire. Quand elle se sent mal, elle se trompe et peine à déplacer ses pions. Peu à peu, le jeune officier japonais éprouve de la tendresse pour cette jeune Mandchoue dont il ne connaît même pas le prénom. Le lecteur voit se nouer sous ses yeux une complicité entre ces deux étrangers tout en sachant que s’ils connaissaient la vérité l’un à propos de l’autre, ils cesseraient aussitôt de jouer. C’est finalement, une histoire d’amour impossible qui naît au fil des pages et dont la concrétisation ne pourra se faire que dans la mort.
Un roman poignant qui n’épargne pas le lecteur confronté à la cruauté de l’homme mais aussi à l’immensité de son amour.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés